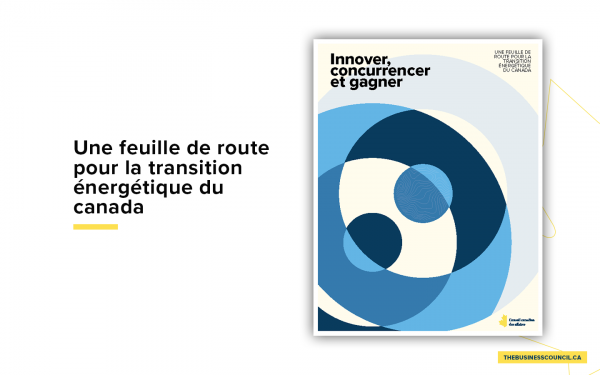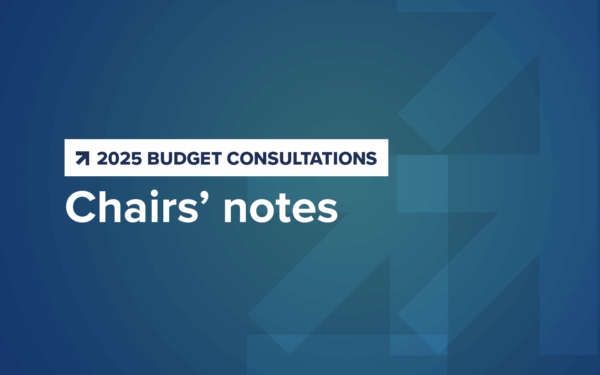Vendre nos forces
Une feuille de route pour tirer parti de l’énergie, de l’agroalimentaire et des minéraux critiques du Canada en période d’incertitude mondiale
Résumé éxécutif
Pour que les Canadiens puissent prospérer dans une période d’instabilité géopolitique, le Canada doit diversifier ses relations commerciales et accroître sa part de marché mondial afin d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique.
Le Canada a l’occasion unique et limitée dans le temps d’accroître ses exportations dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des minéraux critiques. Vendre nos forces reflète le point de vue des chefs d’entreprise qui sont prêts à travailler avec le gouvernement pour saisir cette occasion générationnelle. Grâce à ses activités mondiales et à son réseau de professionnels à travers le monde, le secteur privé canadien est déterminé à aider le pays à étendre sa présence mondiale.
Malgré les accords commerciaux conclus par les gouvernements canadiens successifs, qui accordent un accès préférentiel à plus de 60 % de l’économie mondiale, les Canadiens ne sont pas mieux lotis aujourd’hui qu’il y a dix ans. Le problème est clair. Le Canada ne dispose pas de l’infrastructure physique et réglementaire nécessaire pour tirer pleinement parti de ses atouts naturels et fournir à ses alliés et partenaires commerciaux les produits de base dont ils ont besoin et qu’ils veulent.
Alors que le PIB réel par habitant continue de baisser et que la situation financière du Canada se détériore, les décideurs politiques sont confrontés à la tâche ardue de redresser les perspectives économiques moroses du pays dans un nouveau contexte marqué par la montée du protectionnisme, les menaces économiques et sécuritaires et l’affaiblissement du système commercial multilatéral. La marge d’erreur est très faible.
Le Canada doit tout faire pour approfondir ses liens avec les nations qui partagent ses valeurs et son engagement envers un commerce fondé sur des règles. Le Canada a besoin d’un cadre cohérent qui relie son ambition admirable à des politiques pragmatiques qui renforcent la capacité du pays à produire, à transporter et à enrichir la valeur de ses ressources énergétiques, alimentaires et minérales.
La politique étrangère devrait évoluer pour se concentrer sur la sécurité nationale et l’expansion des intérêts économiques et de l’influence mondiale du pays par le commerce. Une nouvelle stratégie commerciale et un plan d’action peuvent signaler clairement aux partenaires commerciaux que les efforts diplomatiques du Canada viseront le succès commercial et contribueront à la sécurité énergétique, minérale et alimentaire.
La capacité énergétique du Canada — pas seulement le pétrole et le gaz, mais aussi les minéraux critiques, l’uranium et la technologie nucléaire — devrait être mise à profit pour assurer l’avantage stratégique du pays, d’autant plus que le monde a grand besoin de sécurité énergétique. La prochaine ère de la politique énergétique devrait mettre l’accent sur la création de chaînes d’approvisionnement solides et résilientes en Amérique du Nord et sur l’expansion de la capacité du Canada à fournir de l’énergie de manière fiable à ses partenaires commerciaux à l’extérieur du continent. Le Canada devrait chercher à conclure une nouvelle alliance avec les États-Unis et le Mexique afin de maximiser la sécurité énergétique en Amérique du Nord.
Les alliés du Canada s’empressent également de trouver des moyens d’assurer un approvisionnement stable en minéraux pour leurs objectifs de sécurité nationale et de défense. Les chaînes d’approvisionnement en minéraux sont de plus en plus menacées par la manipulation des prix à l’étranger, les contrôles à l’exportation, la demande militaire croissante et les stocks limités des membres de l’OTAN. Le Canada peut devenir un chef de file mondial dans la production et la transformation de minéraux critiques à des fins de défense. Il devrait collaborer immédiatement avec les membres de l’OTAN afin de créer une réserve de minéraux critiques pour la technologie de défense et les besoins militaires. Pour ce faire, il faudra consacrer des ressources fédérales ciblées à l’exploitation minière au Canada.
La militarisation des produits alimentaires et les changements climatiques compromettent dangereusement la sécurité alimentaire mondiale. Le Canada peut et doit retrouver sa position de superpuissance agricole et agroalimentaire. Pour ce faire, il doit tirer parti de ses atouts en tant que grand exportateur de produits de base, tels que les céréales et les légumineuses, ainsi que d’intrants essentiels à la production alimentaire mondiale, comme l’azote et la potasse.
Dans chacun de ces domaines, la capacité du Canada à relever les défis mondiaux en matière de sécurité devrait aller au-delà de l’exportation de produits de base bruts et non transformés. L’exploitation des ressources naturelles pourrait créer une occasion générationnelle de stimuler le progrès technologique, d’accroître la productivité et de développer des ressources avec moins d’émissions. Pour ce faire, le Canada a besoin d’une nouvelle agence fédérale chargée des projets de recherche avancée afin de stimuler l’innovation et d’accroître la compétitivité économique.
En fin de compte, toutefois, pour libérer le potentiel du Canada en matière d’énergie, d’agriculture et de minéraux critiques, il faudra procéder à d’importants changements.
Des réformes réglementaires sont nécessaires dans de nombreux domaines, en particulier en ce qui concerne l’approbation des projets et la délivrance des permis. Les chefs d’entreprise canadiens appuient l’intention du gouvernement de faire progresser le principe « un projet, une évaluation ». Vendre nos forces exhorte le gouvernement à aller plus loin dans ses efforts visant à réduire la redondance réglementaire et à passer à un processus de « une décision » auquel participeraient les détenteurs de droits autochtones.
Une infrastructure commerciale solide est une condition préalable à l’intensification des échanges avec les alliés et les partenaires. Le Canada a besoin de toute urgence d’une stratégie nationale en matière d’infrastructure commerciale, élaborée en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et le secteur privé, afin de renforcer la croissance économique et d’accéder à de nouveaux marchés. Toutefois, une telle stratégie sera insuffisante si les arrêts de travail continuent de se produire à un rythme sans précédent. À cet égard, il est également urgent que le gouvernement s’engage fermement à protéger les chaînes d’approvisionnement du Canada contre de futures perturbations du travail.
Enfin, les exportations à faibles émissions du Canada constituent un avantage concurrentiel qui doit être maintenu au cours des prochaines décennies. L’accès à une électricité abordable est un avantage stratégique depuis des décennies, mais les marchés font maintenant face à une nouvelle ère de contraintes, de coûts plus élevés et de risques pour la sécurité du réseau. Le Canada devrait promouvoir un effort national visant à garantir de nouvelles sources d’électricité fiables, abordables et durables dans des régions stratégiques. Un effort national visant à renforcer la compétitivité des marchés du carbone au Canada est également nécessaire. Cet effort devrait inclure un examen complet des régimes de tarification du carbone et évaluer le potentiel de création de synergies entre les marchés existants.
Le monde a changé, et si nous jouons bien nos cartes, ça pourrait bien être à l’avantage du Canada. Comme on l’a souvent dit, le Canada a ce que le monde veut. Vendre nos forces se veut une feuille de route pour garantir que nous puissions fournir ce que nous avons à ceux qui le veulent, d’une manière qui renforce à la fois la sécurité économique et la croissance économique.
Liste sommaire des recommandations au gouvernement fédéral :
- Revoir la politique étrangère afin d’accroître la part de marché du Canada à l’échelle mondiale
- Élaborer une stratégie et un plan d’action en matière de commerce mondial visant à promouvoir les entreprises canadiennes et à renforcer l’avantage concurrentiel du pays sur les marchés traditionnels et émergents.
- Indiquer clairement que les efforts diplomatiques du Canada viseront à obtenir des succès commerciaux sur les marchés les plus prometteurs pour les entreprises canadiennes et à contribuer à la sécurité énergétique, minérale et alimentaire.
- Mettre en place des envoyés commerciaux, nommés par le gouvernement, qui travailleront directement avec les ambassadeurs régionaux afin d’établir des relations et de faire progresser les possibilités commerciales et d’investissement identifiées par le gouvernement canadien.
- Mettre sur pied un groupe d’experts-conseils en commerce composé de représentants du secteur privé qui travailleront avec le gouvernement afin de partager des renseignements et d’échanger de l’information sur les risques émergents et les possibilités commerciales.
- Libérer l’énergie comme « hard power » (puissance dure) du Canada
- Poursuivre le développement d’une alliance énergétique nord-américaine qui vise à maximiser la sécurité énergétique, les intérêts économiques et géopolitiques communs des États-Unis, du Canada et du Mexique.
- Les objectifs de l’alliance devraient être les suivants :
- S’engager conjointement à une politique énergétique « tout compris » qui oriente les investissements et le soutien politique des secteurs public et privé vers des projets qui renforcent la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement énergétique en Amérique du Nord.
- Renforcer la capacité de renseignement en matière de sécurité énergétique en créant une unité spécialisée chargée de surveiller et de recueillir des informations sur les risques et les menaces pesant sur les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement énergétique et en minéraux critiques de l’Amérique du Nord.
- Créer un groupe de travail réglementaire nord-américain chargé d’élaborer une vision commune pour identifier et approuver rapidement les infrastructures qui renforcent la résilience des chaînes d’approvisionnement énergétique et en minéraux critiques de l’Amérique du Nord, en mettant particulièrement l’accent sur les infrastructures transfrontalières.
- Tirer parti de l’avantage de l’Amérique du Nord pour promouvoir les possibilités commerciales qui allient la politique d’exportation d’énergie et de minéraux critiques aux besoins des alliés et des partenaires commerciaux qui ont besoin d’un approvisionnement sûr et sécurisé en énergie.
- Faire du Canada un important fournisseur de minéraux critiques pour l’OTAN
- Créer une réserve de minéraux critiques au Canada pour les métaux de niche essentiels à des fins de défense stratégique et pour lesquels les mécanismes du marché et l’approvisionnement sont les plus fragiles.
- Collaborer avec l’industrie et le secteur financier afin d’encourager la production et la transformation des minéraux prioritaires au moyen d’un financement concessionnel et d’outils tels que des contrats bilatéraux et des instruments dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme standardisés et les options.
- Consulter les nations autochtones et coopérer avec elles de bonne foi afin d’obtenir leur consentement et harmoniser les systèmes fédéraux et provinciaux d’approbation des projets et de délivrance des permis afin de faire avancer les projets d’intérêt national. Veiller à ce que les programmes d’équité et de partage des avantages offerts aux peuples autochtones prévoient des fonds destinés aux projets miniers et aux infrastructures de soutien.
- Créer un instrument financier dédié aux minéraux critiques pour la défense au Canada, sur le modèle du programme américain DPA Title 3.
- Soutenir les efforts visant à évaluer les besoins des alliés de l’OTAN et à renforcer le potentiel du Canada à devenir un fournisseur de choix dans les domaines stratégiques de la chaîne de valeur des minéraux.
- Libérer les ressources canadiennes grâce à un processus moderne et efficace d’approbation des projets
- Faire progresser le principe « un projet, une évaluation » dans tout le Canada et passer également à « une décision », en veillant à ce que les détenteurs de droits autochtones participent au processus.
- L’objectif devrait être d’assurer que les gouvernements fédéral et provinciaux respectent leurs domaines de compétence respectifs afin que les promoteurs comprennent clairement quelle est l’autorité réglementaire principale.
- Veiller à ce que la participation du public aux processus d’approbation des projets soit définie de manière appropriée, avec des paramètres logiques en place pour la participation du public.
- Afin d’éviter l’incertitude et les risques pour les projets et de ne pas miner la confiance du public, veiller à ce que les gouvernements respectent les normes les plus élevées dans l’application de l’obligation de consulter et d’accommoder.
- Veiller à ce que les délais des processus réglementaires, y compris la délivrance des permis et les approbations de projets aux paliers fédéral et provincial/territorial, soient courts, concrets et respectés.
- Agir rapidement pour définir des processus d’approbation plus courts pour les projets réalisés sur des friches industrielles ou dans des endroits où le promoteur a déjà obtenu un certificat environnemental ou est propriétaire d’un actif, d’une emprise ou d’un corridor existant.
- Allouer des capacités et des ressources suffisantes aux organismes fédéraux responsables de la délivrance des permis.
- Élaborer une stratégie nationale d’infrastructure commerciale et résoudre de façon permanente les perturbations du travail dans les industries essentielles
- Créer une stratégie nationale qui soutient l’infrastructure commerciale et qui met l’accent sur :
- les infrastructures physiques, les ports, les chemins de fer, les pipelines, les routes et la connectivité aux portes d’entrée et aux corridors afin de soutenir le commerce à long terme ;
- la connexion des communautés rurales aux marchés étrangers grâce à l’expansion de l’accès à la large bande afin de soutenir la numérisation des projets agricoles et liés aux ressources naturelles ;
- la résilience face aux changements climatiques et aux menaces à la sécurité.
- S’engager publiquement à régler, par des mesures politiques ou des modifications législatives, les conflits de travail et les actes de désobéissance civile qui nuisent à la capacité du pays de commercer avec ses alliés et ses partenaires commerciaux.
- Assurer l’avenir de l’avantage du Canada en matière de faibles émissions de carbone
Construire une nouvelle ère de production et de transport d’électricité
- Promouvoir un effort national axé sur la réalisation d’un double mandat en matière de production d’électricité et de sécurité du réseau.
- Construire et renforcer les connexions interprovinciales de transport d’énergie afin de créer de nouveaux marchés énergétiques et d’améliorer la fiabilité et la sécurité énergétiques.
- Encourager les provinces et les territoires à élaborer des voies technologiques et des stratégies d’investissement pour produire, stocker, transporter et distribuer une électricité fiable et abordable aux Canadiens.
- Évaluer le développement de la main-d’œuvre, les compétences et le bassin de main-d’œuvre nécessaires pour renforcer la capacité de production d’électricité dans diverses administrations du pays.
- Poursuivre les plans d’infrastructure à long terme visant à renforcer ou à élargir le corridor électrique canado-américain et trouver des moyens de rationaliser les processus d’approbation des infrastructures transfrontalières.
Créer des marchés du carbone concurrentiels pour réduire les émissions industrielles
- Améliorer les programmes de tarification du carbone industriel au Canada en :
- examinant le calendrier de mise en œuvre du prix minimum sur le carbone industriel et les normes d’émissions et les niveaux de rigueur correspondants afin d’évaluer leur incidence sur l’économie, la sécurité énergétique et les industries à forte intensité d’émissions et dépendantes du commerce du Canada.
- augmentant rapidement le nombre de protocoles de compensation offerts à l’industrie et veiller à ce que les revenus tirés des programmes de tarification soient investis dans de nouvelles technologies et dans des installations génératrices d’émissions ; et
- favorisant la compatibilité entre les marchés existants grâce à la création de crédits et à des possibilités d’échange de droits d’émission au Canada.
- Élargir la portée mondiale du Canada en collaborant avec des pays qui partagent les mêmes priorités :
- la sécurité alimentaire, minérale et énergétique à faibles émissions de carbone ;
- la réduction d’émissions grâce à des politiques climatiques comparables ; et
- la dissuasion des pays qui profitent du système en appliquant des réglementations moins strictes en matière de GES.
- Créer une nouvelle agence pour stimuler l’innovation et les technologies performantes
- Créer une agence fédérale de projets de recherche avancée pour stimuler le progrès technologique, l’innovation et la compétitivité économique.
- Mandater l’agence pour assurer un meilleur transfert des technologies entre la recherche financée par les fonds publics et les entreprises canadiennes qui pourraient commercialiser ces idées.
- Créer des programmes spécialisés pour les industries à forte valeur ajoutée axées sur l’exportation, telles que l’agroalimentaire, l’énergie et les minéraux critiques.
- Permettre à l’agence d’investir dans la recherche et le développement à haut risque et à haut rendement, ainsi que dans les technologies issues de la collaboration de l’agence avec le secteur privé.
Mauvais résultats, décennies perdues
S’il y a un moment où il était urgent d’agir, c’est bien maintenant.
En 2024, Carolyn Rogers, première sous-gouverneure de la Banque du Canada, a fait les manchettes lorsqu’elle a déclaré que « l’heure a sonné » de s’attaquer aux piètres résultats persistants du Canada en matière de productivité. [1] Elle a souligné que le Canada avait pris du retard par rapport aux autres pays du G7 dans plusieurs domaines, notamment les investissements en capital, la productivité du travail et la propriété intellectuelle.
Les perspectives économiques du pays sont tout aussi décevantes. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prédit que le Canada se classera dernier parmi les membres de l’OCDE en matière de croissance du PIB réel par habitant jusqu’en 2060.[2] Les politiques commerciales du président américain Donald Trump devraient dégrader les perspectives mondiales à court terme, la croissance au Canada étant estimée à 1,3 % cette année et à seulement 1,1 % en 2026.[3]
Les Canadiens ne sont pas dans une meilleure situation économique aujourd’hui qu’il y a dix ans. Le PIB réel par habitant continue de baisser et se situe pratiquement au même niveau qu’en 2014. Du point de vue des salaires, le salaire hebdomadaire moyen réel a doublé entre 1945 et 1975 grâce à l’amélioration de la productivité. Mais au rythme actuel, il faudrait environ quatre siècles pour obtenir la même amélioration.[4] Le Canada est passé du 6e rang des économies les plus productives de l’OCDE en 1970 au 18e rang en 2022.[5]
La situation financière du Canada se détériore également. Les déficits budgétaires et l’augmentation de la dette constituent des défis financiers majeurs pour le gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements provinciaux. Dans l’ensemble, le ratio combiné de la dette fédérale et provinciale au PIB est passé de 53,1 % en 2007-2008 à 76,2 % en 2023-2024.[6] La situation de la dette brute du Canada est parmi les plus faibles du G7, alors que les agences de notation continuent d’alerter les gouvernements canadiens sur les dangers d’une augmentation des dépenses financées par l’endettement et de la hausse des coûts d’emprunt qui devraient persister dans un avenir prévisible.
Parallèlement, les guerres tarifaires mondiales ébranlent les fondements du commerce canadien et menacent la compétitivité industrielle, la stabilité économique et les perspectives de croissance à long terme du pays. Le premier ministre Mark Carney a engagé son gouvernement à forger une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis. Le Canada doit également renforcer de toute urgence ses liens avec ses autres partenaires commerciaux et nouer des relations avec de nouveaux clients partout dans le monde.
La multiplication des données illustrant les perspectives économiques modestes du Canada et sa situation budgétaire précaire est préoccupante. Cela signifie que la marge de manœuvre du gouvernement fédéral en matière de politique est très faible. Des changements fondamentaux sont nécessaires pour ouvrir la voie à une nouvelle ère de capacité économique qui améliorera le niveau de vie des Canadiens à long terme et fera du Canada l’économie la plus forte du G7.
Contribuer à un nouvel ordre mondial sûr et sécuritaire
L’exacerbation des tensions géopolitiques a mis en évidence la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales en énergie, en matières premières et en denrées alimentaires. Le Canada et ses alliés font face à une nouvelle ère, marquée par des risques géopolitiques accrus. Des entités étrangères manipulent les chaînes d’approvisionnement, exposant les démocraties occidentales à des risques plus élevés pour leur sécurité économique et nationale. La prochaine ère de l’élaboration des politiques doit donc répondre à un nouvel ordre mondial de plus en plus façonné par les menaces économiques et sécuritaires.
Le Canada devrait poursuivre une stratégie de transformation axée sur la croissance économique grâce à l’intensification du commerce des ressources avec ses alliés et ses partenaires commerciaux. Un programme axé sur l’augmentation de la part de marché du pays grâce à l’intensification du commerce des ressources naturelles, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire et des minéraux critiques, peut générer les rendements économiques élevés dont les Canadiens ont besoin de toute urgence. Il peut également faire du Canada un acteur influent dans la résolution de certains des défis les plus urgents au monde en matière de sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que dans l’amélioration des capacités de défense.
La sécurité nationale et les applications liées à l’énergie propre stimulent la demande mondiale en minéraux critiques
- Les démocraties occidentales se livrent à une course pour s’assurer un approvisionnement stable en minéraux critiques, notamment le tungstène, les éléments des terres rares et le germanium, afin de renforcer leur sécurité économique et leur défense nationale. Cependant, les chaînes d’approvisionnement de nombreux métaux de niche sont dominées par la Chine, les États-Unis dépendant de plusieurs entités étrangères préoccupantes.
- L’essor des centres de données nécessitera des matériaux énergétiques critiques, notamment l’uranium, le lithium, le nickel et le cuivre. Ils sont tous confrontés à des déficits d’approvisionnement à long terme.[7]
- La demande en minéraux pour les technologies d’énergie propre devrait doubler ou tripler d’ici 2030.[8]
- Selon les scénarios de l’AIE, le stockage par batterie sera multiplié par 6 pour atteindre 1 500 GW d’ici 2030, les batteries représentant 90 % de cette capacité de stockage.[9]
- De plus en plus de pays cherchent à réduire leur commerce avec la Chine et la Russie, une évolution qui pourrait faire du Canada un partenaire commercial privilégié pour les matières premières.
La menace mondiale de l’insécurité alimentaire s’accroît
- Environ 10 % de la population mondiale souffre d’une pénurie alimentaire.[10]
- Les pénuries et l’envolée des prix des denrées alimentaires de base ont plongé 345 millions de personnes dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë. Les pays à faible revenu, dont beaucoup s’approvisionnent auprès de régimes autoritaires, sont les plus vulnérables.[11]
- La population mondiale devrait augmenter de 26 % et atteindre 9,8 milliards de personnes d’ici 2050.[12]
- L’augmentation des revenus mondiaux devrait entraîner une hausse de la consommation alimentaire totale de 50 à 70 % d’ici 2050, la demande en Inde et en Asie du Sud-Est devant croître de 31 % au cours de la prochaine décennie.[13]
Tout semble indiquer que la consommation mondiale d’énergie va augmenter
- L’incertitude géopolitique et celle qui pèse sur les marchés énergétiques ont des répercussions négatives sur la sécurité énergétique dans le monde entier.
- La demande mondiale en énergie devrait augmenter de 10 à 15 % d’ici 2050.[14] L’approvisionnement mondial en électricité des centres de données devrait passer de 1,2 à 4,1 % d’ici 2030.[15]
- L’Europe est plus vulnérable que jamais, puisqu’elle dépend des importations pour plus de 50 % de ses besoins énergétiques, un nouveau record pour la région.
- Quatre-vingts pour cent de la population mondiale vit dans des pays où la consommation d’électricité par habitant est faible.
- La production d’énergie primaire (pétrole, gaz naturel, charbon, énergie nucléaire et sources renouvelables) augmentera de 16 à 57 % d’ici 2050, le gaz naturel étant bien placé pour devenir le combustible de l’avenir.
- La demande mondiale annuelle en énergie est principalement satisfaite par les combustibles fossiles produits dans des pays dont les champs de pétrole et de gaz sont en déclin. Selon l’AIE, de nouveaux investissements dans les réserves existantes de pétrole et de gaz sont nécessaires pour garantir la sécurité énergétique mondiale.[16]
Les pays du Nord comme ceux du Sud se précipitent pour s’assurer des sources sûres et fiables de toutes les formes d’énergie, alors que les plus grandes économies mondiales placent la sécurité énergétique au cœur de leurs programmes de sécurité nationale.
Les gouvernements successifs des États-Unis ont donné la priorité à la sécurité énergétique. L’administration de Joe Biden a appelé les entreprises pétrolières américaines à augmenter leurs investissements et leur production, tout en autorisant la libération de la réserve stratégique de pétrole du pays avant et après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Le jour même de son investiture pour un second mandat, Donald Trump a déclaré l’état d’urgence énergétique national. « Un approvisionnement énergétique national abordable et fiable est une condition fondamentale pour la sécurité nationale et économique de tout pays », a-t-il déclaré, ajoutant que la politique énergétique américaine serait conçue pour « protéger la sécurité économique et nationale des États-Unis et leur préparation militaire en garantissant un approvisionnement abondant en énergie fiable et facilement accessible dans chaque État et territoire ».
L’Allemagne, la Chine et l’Inde ont également pris des décisions politiques audacieuses pour placer la sécurité énergétique au cœur de leurs stratégies de sécurité économique et nationale.
La domination de la Chine dans la fabrication de technologies de pointe, jumelée à sa capacité inégalée à exploiter et à traiter des minéraux critiques, souligne sa capacité à influencer un large éventail de marchés, qu’il s’agisse de l’énergie, de la défense ou des technologies propres. En 2024, la Chine contrôlait plus de 85 % du traitement mondial des terres rares et 60 % de la capacité de raffinage du lithium, ce qui lui conférait une influence sans précédent sur les technologies essentielles au renforcement des capacités de défense, à la numérisation et à la décarbonation.[17]
L’incidence économique de ce pays est évidente dans la désindustrialisation en Amérique du Nord et d’autres régions du monde, ainsi que dans les déséquilibres commerciaux sur les principaux marchés, comme les États-Unis. Du point de vue de la sécurité, la menace est devenue très réelle. La Chine est désormais une puissance mondiale. Un conflit régional en Asie pourrait avoir des conséquences considérables pour le Canada et ses alliés en matière d’accès aux matériaux et aux technologies nécessaires pour renforcer leurs capacités de défense.
Les répercussions de cette réalité se font sentir sur le plan économique sous forme de désindustrialisation et de déséquilibres commerciaux. Mais elles sont encore plus préoccupantes du point de vue de la sécurité. En cas de conflit régional impliquant la Chine, par exemple au sujet de Taïwan, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ne pourraient pas compter sur les biens chinois pour maintenir leur base industrielle de défense. La Chine a déjà manifesté sa volonté d’imposer des restrictions à l’exportation de minéraux critiques et de composants essentiels à la défense, notamment les drones et l’industrie aérospatiale.
La dépendance de l’Europe à l’égard du gaz naturel russe rappelle également à l’Occident que les pays dont la balance commerciale énergétique est déficitaire doivent réduire leur dépendance à l’égard de pays autocratiques qui cherchent à dominer leurs chaînes d’approvisionnement en énergie et en matières premières. Les prix élevés de l’énergie coûtent des vies. Une étude récente montre que la capacité de la Russie à interrompre ses livraisons de gaz naturel à l’Europe a provoqué une telle flambée des prix que les gens ont renoncé à se chauffer correctement et à vivre confortablement. Une hausse des prix d’environ 0,10 € par kWh a été liée à une augmentation de la mortalité hebdomadaire d’environ 2,2 % dans un pays.[18]
L’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie a également entraîné de profondes répercussions sur le système mondial d’approvisionnement énergétique. Les pays européens se sont empressés de trouver de nouvelles sources de gaz naturel liquéfié (GNL), dont plus de la moitié a été fournie par des fournisseurs américains. La capacité de l’Europe à payer un prix élevé pour le GNL a eu un coût élevé pour les pays en développement d’Asie et d’Afrique, dont beaucoup ont été exclus du marché du gaz naturel et contraints de revenir à des formes d’énergie plus polluantes, comme le charbon, le bois, les déchets et la bouse de vache.
Plus près de chez nous, des adversaires comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l’Iran et des entités non étatiques mènent constamment des cyberattaques contre les infrastructures énergétiques canadiennes et américaines. La cyberattaque contre le pipeline Colonial Oil en 2021 et l’attaque physique contre les infrastructures électriques en Caroline du Nord l’année suivante montrent que les actifs énergétiques de l’Amérique du Nord sont de plus en plus menacés. Au Canada, le Centre pour la cybersécurité a averti que le secteur pétrolier et gazier du pays est déjà confronté à des menaces provenant d’entités soutenues par des États, qui pourraient s’aggraver en cas de conflit entre les États-Unis et la Russie et la Chine.[19]
Du point de vue de la politique climatique, la résurgence mondiale du charbon représente la plus grande menace pour la décarbonation. La demande mondiale de charbon a atteint un nouveau record de 8,70 milliards de tonnes (Gt) en 2023, dépassant de 2,6 % le record de l’année précédente. Plus de 80 % de la consommation de charbon a eu lieu en Asie et dans d’autres régions du monde où il existe moins d’énergies alternatives. Il y a également de fortes indications que le rythme de la transition énergétique mondiale est menacé en raison du déficit prévu en minéraux nécessaires à la production et au transport d’énergies renouvelables, ainsi qu’à une large gamme de technologies de batteries et de stockage.[20]
La guerre en Ukraine met également en évidence un autre défi de taille : la militarisation des produits alimentaires. Le choc causé par ce conflit prolongé sur la production et le commerce agricoles est l’un des principaux facteurs de la crise alimentaire mondiale qui a presque triplé le taux de faim aiguë depuis 2020, exposant pas moins de 333 millions de personnes à un risque de famine.[21] Les pays à faible autosuffisance alimentaire sont parmi les plus vulnérables à la militarisation des produits alimentaires. Par exemple, le Japon, qui est la troisième économie mondiale, n’a un taux d’autosuffisance alimentaire que de 38 % et dépend fortement des importations de denrées alimentaires.
Le Canada est particulièrement bien placé pour relever les défis mondiaux liés à la sécurité énergétique et alimentaire. Son agriculture abondante, ses ressources naturelles riches et ses pratiques environnementales exemplaires figurent parmi les meilleures au monde dans tous les domaines. Le Canada est indépendant sur le plan énergétique, quelle que soit la source, dispose d’un accès abondant à l’eau douce et aux minéraux, et peut se targuer d’avoir des secteurs financiers et une main-d’œuvre de calibre mondial. Les Canadiens sont également prêts à voir le Canada agir davantage sur la scène internationale. Par exemple, des sondages récents indiquent que la plupart des Canadiens estiment que le pétrole et le gaz sont importants pour l’économie actuelle et future du pays et que l’expansion des exportations de pétrole et de gaz peut renforcer la sécurité énergétique mondiale.[22]
Mais l’exploitation des ressources naturelles au Canada n’est pas une tâche facile en raison des nombreux défis liés à l’incertitude réglementaire et politique, aux procédures d’approbation et de délivrance de permis lents et laborieux, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à l’absence de consensus parmi les décideurs politiques sur les projets à soutenir.
Un exemple concret :
- Entre 2015 et 2023, la valeur réelle des grands projets en dollars constants de 2015 a chuté d’environ 33,5 % (soit 231,3 milliards de dollars).
- Le nombre de projets liés aux ressources naturelles a diminué de 10,04 %.
- La valeur moyenne des projets a chuté de 6,1 %.
- Le nombre total de projets achevés a diminué de 36 %23.
Les riches ressources énergétiques et naturelles du Canada lui confèrent une position avantageuse, lui permettant de répondre à la demande d’un monde à la recherche de plus d’énergie et de biens avec moins d’émissions. Toutefois, des solutions urgentes aux défis politiques de longue date et une nouvelle culture d’engagement en faveur du développement desressources naturelles sont nécessaires pour libérer tout le potentiel du Canada.
L’avantage du Canada en matière de faibles émissions de carbone : une force concurrentielle
Les changements climatiques restent l’un des plus grands défis de notre époque.
Bien que les engagements du Canada dans le cadre de l’Accord de Paris soient ambitieux, des données récentes semblent indiquer que le pays commence à découpler ses émissions de sa croissance économique. Les émissions nationales restent environ 6 % inférieures aux niveaux d’avant la pandémie de 2019, tandis que l’économie canadienne a connu une croissance de 3,2 % depuis lors.[24] L’abondance d’électricité propre, fiable et abordable, notamment l’énergie nucléaire et le gaz naturel à faibles émissions, a permis au Canada d’abandonner progressivement l’électricité produite à partir du charbon. Ses programmes de tarification du carbone industriel se sont également révélés être efficaces pour réduire les émissions dans l’ensemble de la base industrielle et des secteurs des ressources naturelles du Canada.
Si l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici le milieu du siècle peut sembler ambitieux, les chefs d’entreprise restent convaincus que les émissions mondiales doivent diminuer de manière significative. Les entreprises de tout le Canada contribuent à cet effort en investissant des milliards de dollars pour transformer leurs activités à l’aide de technologies industrielles innovantes, de formes d’énergie à faibles émissions et de chaînes d’approvisionnement conçues pour livrer les produits aux clients et aux consommateurs en générant le moins d’émissions possible. L’avantage du Canada en matière de faibles émissions de carbone repose sur l’accès inégalé à une électricité fiable, abordable et à faibles émissions.
Le Canada se classe parmi les producteurs les moins polluants de plusieurs minéraux critiques, comme le cuivre, le nickel et l’aluminium, ainsi que de dizaines de produits agroalimentaires allant du canola aux légumineuses, en passant par les produits laitiers et le bœuf. L’industrie pétrolière et gazière classique a réduit ses émissions d’environ 25 % au cours de la dernière décennie, tandis que la production GNL canadienne est l’un des plus faibles émetteurs au monde.[25]
D’un point de vue commercial, de nombreuses exportations canadiennes ont une empreinte carbone inférieure à celle des produits concurrents ou qu’elles remplacent. Alors que les marchés mondiaux continuent de rechercher des solutions de rechange à faibles émissions de carbone et que de plus en plus de pays cherchent des moyens d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, l’avantage du Canada en matière d’exportations à faibles émissions de carbone devrait être mis en avant comme un avantage concurrentiel et un pôle d’attraction pour les investissements sur les marchés où la demande reste forte, comme le gaz naturel et pour de nombreux produits agroalimentaires et minéraux critiques.
Produits agroalimentaires :
- Le Canada est l’un des principaux exportateurs de denrées alimentaires, avec un système alimentaire qui se classe parmi les plus durables, selon l’indice de durabilité alimentaire (FSI).[26]
- Plus de 65 % des agriculteurs canadiens ont adopté au moins une pratique pour améliorer la résilience de leur exploitation face à des défis défavorables en matière de sol, d’eau ou de biodiversité.[27]
- Le blé, le canola, les lentilles et les pois canadiens sont produits avec des émissions nettement inférieures à celles de leurs concurrents internationaux. Les bovins laitiers et de boucherie canadiens ont l’une des empreintes les plus faibles au monde, avec des émissions de gaz à effet de serre (GES) par kilogramme de viande bien inférieures aux moyennes mondiales.[28]
Exploitation minière et minéraux critiques :
- Les émissions totales de carbone du Canada pour l’aluminium, le cuivre, l’or, le minerai de fer, la potasse et le charbon métallurgique sont inférieures à celles de l’Australie, des États-Unis, de la Russie, de l’Afrique du Sud, de l’Indonésie, du Chili et du Brésil.[29]
- Le Canada est l’un des principaux producteurs mondiaux de nickel et le deuxième producteur mondial de nickel à faible intensité carbone.[30]
- Le Canada possède une expertise inégalée dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en uranium et en technologie nucléaire.
Énergie :
- Les émissions du secteur pétrolier et gazier ont baissé en valeur absolue de 8 % depuis 2014 et de 34 % en intensité depuis 2012.[31] Les entreprises pétrolières et gazières canadiennes figurent parmi les plus faibles émetteurs de méthane au monde.[32]
- Selon l’AIE[33],[34] la transition du charbon au gaz naturel pour la production d’électricité permet de réduire les émissions de 35 à 50 % en moyenne. La proximité du Canada avec le marché émergent de l’Asie-Pacifique constitue un avantage concurrentiel.
- La production de substances chimiques au Canada est jusqu’à 80 % moins intensive en GES que dans les pays d’Asie et d’Europe.[35]
- Le Canada possède le deuxième réseau électrique le plus propre du G7 et le troisième du G20.
Sur le plan des émissions, 45 % des émissions du pays quittent le territoire sous forme d’exportations à faibles émissions en carbone, telles que l’énergie, l’acier, les minéraux et le canola, ce qui permet aux partenaires commerciaux du Canada de réduire leurs émissions en utilisant des produits à faible intensité de carbone ou en remplaçant les produits importés auprès de pays à plus forte intensité d’émissions.[36]
Le cadre international pour la mesure et la déclaration des émissions prévu par l’Accord de Paris ne reconnaît pas les contributions des exportateurs à faibles émissions, comme le Canada, aux réductions d’émissions mondiales. On peut soutenir que les intérêts du Canada sur la scène internationale ont toujours été peu représentés et que le cadre international de mesure des émissions ne reconnaît pas suffisamment les réalisations du Canada.
Un changement de stratégie de la part des décideurs politiques est nécessaire pour mieux positionner les entreprises canadiennes en tant que catalyseurs des occasions à faibles émissions de carbone à l’étranger. L’achèvement récent des règles de l’article 6 lors de la COP 29 pourrait stimuler la coopération internationale fondée sur le marché en mobilisant des investissements privés dans des projets de pays cherchant à atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions. Le Canada devrait rapidement tirer parti de cette évolution et mettre en œuvre un cadre ambitieux visant à réduire les émissions mondiales grâce à une augmentation des échanges commerciaux canadiens de produits de base à faibles émissions de carbone, tels que l’énergie, les minéraux critiques et les produits agricoles durables.
Libérer le potentiel d’exportation du Canada
Le commerce est le moteur de l’économie canadienne, générant environ les deux tiers du PIB du pays.[37] Les Canadiens profitent d’un niveau de vie relativement élevé grâce à l’excellence des entreprises canadiennes sur les marchés d’exportation. Une part importante de ces exportations provient de l’extraction, de la production et de la transformation des ressources naturelles.
Mais le Canada peine à faire croître ses exportations par habitant, la valeur des exportations ayant stagné depuis 2000.[38] Cela semble indiquer une baisse de la compétitivité canadienne pour les industries axées sur l’exportation et celles qui ont une capacité d’exportation, les investissements directs étrangers (IDE) sortants du Canada augmentant plus rapidement que les IDE faits au Canada.
Pour étendre la présence sur les marchés mondiaux, il faudra faire preuve de détermination, d’intentionnalité et d’une volonté sans précédent d’atteindre des niveaux de production plus élevés dans les secteurs de l’énergie et des ressources du Canada. Les futurs décideurs politiques devront promouvoir les intérêts du Canada en poursuivant deux objectifs : renforcer la production économique du pays et répondre aux besoins des alliés et des partenaires commerciaux en matière d’énergie, de denrées alimentaires et de minéraux critiques à faibles émissions.
Comment accroître la part de marché du Canada ?
La réorientation de la politique étrangère du Canada en vue d’approfondir les relations du pays avec ses alliés et ses partenaires commerciaux exige à la fois de la discipline et de la concentration.
Le Canada a la chance d’avoir 14 accords de libre-échange bilatéraux et régionaux en vigueur, couvrant 51 pays et près des deux tiers du PIB mondial. À bien des égards, le Canada bénéficie déjà d’un accès considérable aux marchés mondiaux. Avec ses ressources naturelles abondantes, peu de pays peuvent se prévaloir de l’avantage comparatif dont dispose le Canada par rapport à ses alliés.
Malgré cet avantage, le Canada a enregistré un déficit commercial global la plupart des années depuis 2008. [39] Il importe plus de biens et de services qu’il n’en produit. Au cours de la dernière décennie, les déficits des comptes courants du pays avec le reste du monde ont oscillé entre 2 et 3 % du PIB. Les exportations hors énergie sont restées stables et la part des exportations canadiennes vers les économies émergentes est l’une des plus faibles des pays du G7. Le Canada perd des parts de marché mondiales dans plusieurs domaines importants, notamment les minéraux, l’agroalimentaire et la foresterie. Le Canada ne figure plus parmi les cinq premiers producteurs de minéraux importants, comme le nickel, le cobalt, le graphite et le cuivre.
Même si le Canada continue d’augmenter ses exportations annuelles de produits agricoles et agroalimentaires en chiffres absolus, il continue de perdre des parts de marché. De 1990 à 2005, le pays était le troisième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, avec une part de marché mondial moyenne de 3,6 %. Mais depuis 2000, la part de marché du Canada a diminué de 12 %, tandis que son classement international est passé de la cinquième à la septième place en raison de la croissance des parts de marché du Brésil et de la Chine.[40]
En tant qu’économie de taille moyenne fortement dépendante des exportations, le Canada doit faire face à la montée du protectionnisme, à l’érosion de l’ordre international multilatéral fondé sur des règles et aux changements géopolitiques qui l’isolent de plus en plus sur la scène mondiale. Le Canada, comme le reste du monde, doit également relever le défi à multiples facettes des changements climatiques mondiaux, notamment la nécessité de mettre en place des infrastructures plus résilientes aux changements climatiques et d’investissements financiers importants pour soutenir la transition vers une société à faibles émissions de carbone.
Les résultats médiocres du Canada en matière d’exportation rendent ses principaux alliés, tels que les États-Unis et l’Europe, de plus en plus dépendants d’autres pays, notamment la Chine, la Russie et d’autres régimes autocratiques, pour leur approvisionnement.
La politique étrangère du Canada a fait l’objet de critiques dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale et la politique de défense. Parallèlement, la réputation du pays en tant que nation commerciale fiable a été remise en question en raison de conflits de travail récurrents dans les ports, les chemins de fer et les compagnies aériennes, ainsi que d’actes de désobéissance civile, tels que les barrages de pipelines et de chemins de fer en 2020, l’occupation illégale du pont Ambassador et les actions du « Convoi de la liberté » à Ottawa en 2022.
Les appels à une révision de la politique étrangère continuent de se multiplier, alors que certains s’inquiètent de voir le Canada s’éloigner de ses valeurs fondamentales traditionnelles, axées sur la sécurité nationale, la promotion des intérêts économiques et l’exercice d’un rôle influent sur la scène mondiale.[41]
Les futurs décideurs politiques ont l’occasion de rétablir la réputation du Canada en tant qu’allié crédible et fournisseur influent des produits de base et des biens nécessaires pour relever certains des défis les plus pressants du monde en matière d’énergie et de sécurité alimentaire. Les gains potentiels sont considérables si le Canada peut agir rapidement. Par exemple, un rapport récent publié par RBC a révélé que l’optimisation du potentiel du commerce agroalimentaire du Canada de 30 % d’ici 2035 pourrait générer 44 milliards de dollars supplémentaires en recettes d’exportation.
Recommandations :
- Élaborer une stratégie commerciale mondiale et un plan d’action visant à promouvoir les entreprises canadiennes et à renforcer l’avantage concurrentiel du pays sur les marchés traditionnels et émergents. Indiquer clairement que les efforts diplomatiques du Canada viseront à obtenir des succès commerciaux sur les marchés les plus prometteurs pour les entreprises canadiennes et à contribuer à la sécurité énergétique, minérale et alimentaire.
- Mettre en place des envoyés commerciaux, nommés par le gouvernement, qui travailleront directement avec les ambassadeurs régionaux afin d’établir des relations et de faire progresser les possibilités commerciales et d’investissement identifiées par le gouvernement canadien. Les envoyés commerciaux doivent posséder une expérience démontrable dans la promotion des débouchés sur les marchés des produits de base liés aux objectifs commerciaux du Canada.
- Mettre sur pied un groupe d’experts-conseils en commerce composé de représentants du secteur privé qui travailleront avec le gouvernement afin de partager des renseignements et d’échanger de l’information sur les risques émergents et les possibilités commerciales.
La capacité énergétique du Canada est un « hard power » (puissance dure)
La prochaine ère de la politique énergétique au Canada devrait se concentrer sur deux résultats : créer des chaînes d’approvisionnement énergétique solides et résilientes dans toute l’Amérique du Nord et étendre la portée mondiale du Canada afin de fournir à nos alliés et partenaires commerciaux un approvisionnement sûr et fiable en énergie propre et en minéraux critiques, à un coût abordable.
Aucune autre région du monde ne peut renforcer la sécurité énergétique et parvenir à une position dominante dans le domaine de l’énergie comme le fait l’Amérique du Nord. Le continent produit aujourd’hui plus de pétrole et de gaz que toute autre région du monde. La puissance combinée du secteur énergétique nord-américain le place au premier rang des producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel, au premier rang des exportateurs de GNL et au troisième rang des exportateurs de pétrole brut. Une production d’une telle ampleur constitue un avantage dont l’Europe et la Chine continentale ne disposent pas.
Le Canada part d’une position de force. Il est le quatrième producteur de pétrole, le cinquième producteur de gaz naturel, le deuxième producteur d’uranium et le sixième producteur d’énergie nucléaire au monde. L’abondance de ses ressources énergétiques le place en position de force pour répondre aux besoins de sécurité de ses alliés et partenaires commerciaux qui exigent une combinaison optimale de sources d’énergie différentes afin d’équilibrer leur propre approvisionnement en énergie et leurs priorités en matière de sécurité. Il ne fait aucun doute que la capacité énergétique du Canada constitue la forme la plus importante de « hard power » du pays.
Un approvisionnement stable en énergie abondante et abordable, jumelé à un système de transport intégré, a permis à l’Amérique du Nord de rester compétitive en marquant une ère d’investissements sans précédent au cours des deux dernières décennies. Cette évolution est principalement due à la révolution du pétrole de schiste aux États-Unis et à l’expansion des sables bitumineux au Canada.
Les politiques visant à développer les ressources énergétiques grâce à un large éventail de découvertes technologiques ont généré un rendement remarquable : les investissements en amont en Amérique du Nord sont passés d’environ 50 milliards de dollars américains en 2001 à 250 milliards de dollars américains en 2014, et les dépenses d’investissement en amont devraient augmenter de 77 milliards de dollars américains entre 2024 et 2030. C’est plus que toutes les autres régions du monde réunies.[42] Les investissements dans les énergies renouvelables ont également connu une croissance soutenue, bien qu’à un rythme nettement inférieur à celui du pétrole et du gaz.
Ces avantages ne se limitent pas à générer des rendements élevés pour les marchés financiers. Ils mettent en évidence le potentiel de ce qui peut être réalisé lorsque les objectifs politiques nord-américains sont harmonisés plutôt que fragmentés. Dans ce cas, le continent nord-américain a prouvé qu’il pouvait devenir un producteur et un exportateur de premier plan grâce à son accès aux plus grands marchés financiers du monde pour les nouvelles sources d’énergie et technologies. Les ressources et la capacité d’exportation de l’Amérique du Nord peuvent offrir une solution à court terme aux défis mondiaux en matière de sécurité énergétique et d’énergie à faibles émissions de carbone.
Le rôle du Canada en tant que fournisseur important du marché nord-américain ne peut être sous-estimé. La croissance des importations de pétrole canadien vers les États-Unis représente un facteur clé à la réduction de la dépendance américaine à l’égard des pays de l’OPEP, le Canada représentant actuellement 60 % des importations américaines de pétrole et environ 100 % de celles de gaz naturel. Le récent lancement du projet d’agrandissement du réseau de Transmountain et celui de LNG Canada permettront également d’élargir l’accès mondial au pétrole et au gaz canadiens, principalement dans la région Asie-Pacifique et sur les marchés stratégiques de la côte ouest des États-Unis.
La croissance des exportations d’énergie nord-américaines a également joué un rôle de premier plan en aidant à combler le vide laissé par le déclin des exportations russes vers l’Europe, l’Asie et d’autres régions. Cette croissance est en grande partie attribuable à l’augmentation de la capacité d’exportation de GNL du continent sur la côte américaine du golfe du Mexique, à l’émergence de nouveaux débouchés au Mexique et au projet LNG Canada ici au pays. L’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde auraient été nettement plus vulnérables à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sans ce renforcement des capacités.
Pourtant, le potentiel du Canada en tant que puissance énergétique mondiale n’en est qu’à ses débuts. Il y a environ 15 ans, le Canada et les États-Unis étaient tous deux sur le point d’exporter des volumes importants de gaz naturel vers l’Europe, l’Asie et d’autres régions. Depuis lors, 18 propositions ont été présentées pour faire avancer des projets de GNL au large des côtes canadiennes, dont un seul devrait être mis en service cette année et plusieurs autres entre 2027 et 2030.[43] Les coûts élevés, la complexité réglementaire et le manque d’harmonisation des politiques entre les gouvernements ne sont que quelques-unes des raisons qui ont empêché le Canada de réaliser son potentiel de développement du gaz naturel. Au total, la capacité de GNL du Canada pourrait atteindre 6,62 milliards de pieds cubes par jour (Gpi³/j), soit un peu plus de la moitié de ce que les États-Unis exportent actuellement en tant que premier exportateur mondial de GNL.[44]
Pour redéfinir les intérêts commerciaux du Canada à l’extérieur de l’Amérique du Nord, le gouvernement devra déployer des efforts concertés afin de collaborer étroitement avec le secteur privé pour garantir l’accès et un avantage stratégique sur les marchés à la recherche de produits canadiens. Un sentiment d’urgence et des partenariats plus étroits entre les dirigeants politiques et le secteur privé sont nécessaires pour attirer les investissements et garantir des possibilités d’exportation à long terme avec d’autres pays à la recherche de produits canadiens. Les États-Unis en sont un exemple : le gouvernement fédéral et l’État de l’Alaska collaborent actuellement avec des investisseurs et des opérateurs privés pour accroître la part de marché américain du gaz naturel en concluant des accords avec le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.
Le maintien d’une gamme d’options énergétiques nord-américaines permettra aux alliés et partenaires commerciaux du continent de réduire leur dépendance à l’égard des approvisionnements énergétiques de l’OPEP, du Qatar et de la Russie. Cela aidera également les pays à atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions en abandonnant progressivement le charbon au profit du gaz naturel. Pour assurer la croissance économique et la sécurité du Canada aujourd’hui, et la sécurité énergétique mondiale demain, le Canada doit créer les conditions nécessaires pour construire plus rapidement et plus efficacement des infrastructures énergétiques. Cela permettra également de soutenir le secteur manufacturier en difficulté du pays, en utilisant davantage d’intrants et de matériaux canadiens pour les projets d’intérêt national.
Ces objectifs ne pourront être atteints de manière isolée. Le Canada devrait chercher à revitaliser ses relations commerciales avec les États-Unis et le Mexique afin de prioriser la mise en place de chaînes d’approvisionnement résilientes en énergie et en minéraux critiques dans toute l’Amérique du Nord. Ces trois pays entretiennent depuis plusieurs décennies une collaboration et une coopération de longue date.
Il est regrettable que les relations nord-américaines se soient détériorées ces derniers mois, mais elles peuvent et doivent être rétablies. La production énergétique du Canada et des États-Unis, associée à la capacité potentielle du Mexique à raffiner et transformer le pétrole et le gaz, peut servir de base à la création de marchés énergétiques stables et à la réduction de la pauvreté énergétique en Amérique du Nord, tout en améliorant l’accès de chaque pays aux marchés mondiaux.
Pourtant, la coopération trilatérale en matière d’énergie s’est affaiblie ces dernières années, répartie entre de nombreux groupes de travail et protocoles d’entente dirigés par de multiples ministères et agences dont les mandats et l’expertise varient. Bien que l’Accord Canada-États-Unis-Mexique comprenne d’importantes dispositions relatives au commerce de l’énergie, la collaboration entre les dirigeants nord-américains de l’énergie s’est estompée, la dernière réunion des ministres nord-américains de l’énergie ayant eu lieu en 2017.
Minéraux critiques et technologie nucléaire
Les décideurs politiques s’accordent de plus en plus sur la nécessité de sécuriser les différents minéraux et métaux nécessaires à la sécurité nationale et aux nouvelles technologies de l’énergie et des transports. Une formidable occasion se présente au Canada.
La capacité mondiale d’extraction et de raffinage des minéraux critiques est extrêmement concentrée, l’essentiel des ressources minérales brutes et de la capacité de traitement se trouvant dans un petit nombre de pays mal gouvernés. La Chine a accaparé le marché des intrants minéraux essentiels à la transition énergétique et à la sécurité nationale. Plus des deux tiers de la production mondiale de cobalt, de graphite et d’éléments des terres rares proviennent de Chine, tandis que la position dominante du pays dans le domaine de la transformation est encore plus solide. Si l’approvisionnement en minéraux critiques de la Chine est limité, sa position dominante a été renforcée en partie par sa capacité à s’approvisionner auprès d’une poignée de fournisseurs importants, notamment la République démocratique du Congo, les Philippines, l’Indonésie et le Myanmar.
Selon les données de l’AIE, la Chine raffine plus de 90 % du graphite mondial, 90 % des éléments des terres rares, les trois quarts du cobalt et près des deux tiers du lithium. La Chine domine également la production de technologies propres, avec respectivement 75 % et plus de 80 % de la capacité mondiale de fabrication de batteries et de panneaux solaires. Cette domination représente un risque pour la position énergétique de l’Amérique du Nord et compromet les efforts mondiaux visant à réduire les émissions conformément aux engagements internationaux.
À l’inverse, les minéraux extraits en Amérique du Nord traversent et retraversent la frontière lorsqu’ils passent par différentes étapes de transformation et de fabrication. Le Canada figure parmi les dix premiers pays en matière de réserves de minéraux importants, tels que le nickel, le lithium et le cobalt, et est l’un des principaux producteurs d’aluminium, de minerai de fer, de cuivre ainsi que d’indium, de niobium, d’éléments du groupe du platine et de concentré de titane. Il reste également la principale source d’importation des États-Unis pour l’aluminium, le nickel, l’acier, le cuivre et le niobium.
Annoncé en 2020, le Plan d’action conjoint Canada–États-Unis pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques favorise une approche intégrée pour le développement des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et constitue un point de départ utile pour renforcer le commerce continental. Le Plan d’action sur les minéraux critiques du G7, récemment présenté, pourrait également s’avérer utile à cet égard. Mais il reste encore beaucoup à faire pour surmonter les défis auxquels l’Amérique du Nord est confrontée en matière de financement, de délivrance de permis et, en fin de compte, de sécurisation d’un approvisionnement en minéraux à des fins de défense, de transition énergétique et de fabrication de pointe.
Il ne faut pas sous-estimer la capacité du Canada à soutenir un développement robuste de la technologie nucléaire en Amérique du Nord et au-delà. Le Canada est le deuxième producteur d’uranium au monde et fournit aux États-Unis près de 30 % de leurs importations d’uranium. Les investissements dans le bassin de l’Athabasca, en Saskatchewan, qui possède les gisements d’uranium les plus riches au monde, augmentent — plusieurs nouveaux projets ayant atteint des stades avancés — pour compléter les mines existantes de classe mondiale. Comparativement, la production d’uranium aux États-Unis est à l’un de ses plus bas niveaux historiques, tandis que le Mexique n’exploite pas d’uranium.
Outre la production d’uranium, le Canada a mis en place une chaîne d’approvisionnement nucléaire robuste qui comprend également la production. Comme toute l’énergie nucléaire commerciale actuelle du Canada est produite par des réacteurs CANDU, qui utilisent une technologie de l’eau lourde, il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’uranium enrichi. Cela signifie que la chaîne d’approvisionnement nucléaire du Canada est presque entièrement nationale, ce qui lui confère un degré incroyable d’indépendance énergétique. Les récents travaux de réfection des installations de Bruce, Darlington et, en temps voulu, Pickering en Ontario — des projets colossaux de plusieurs milliards de dollars qui ont été menés à bien dans les délais et les budgets prévus — ont permis au secteur nucléaire canadien de fonctionner à plein régime.
Il s’agit là d’un avantage stratégique et concurrentiel considérable au moment où le monde s’oriente vers une renaissance du nucléaire. Le Canada, les États-Unis et 29 autres pays ont signé une déclaration dans laquelle ils s’engagent à tripler la capacité de production d’énergie nucléaire d’ici 2050. Cet objectif est motivé par la volonté d’investir dans une énergie de base plus propre et de renforcer la sécurité énergétique, et il est soutenu par une nouvelle génération de technologies nucléaires. Celles-ci comprennent des réacteurs modulaires de petite taille et des réacteurs à grande échelle qui offrent de nouvelles applications pour l’énergie nucléaire tout en renforçant la sécurité.
Le Canada tire déjà parti de la nouvelle demande en énergie nucléaire, notamment en prenant des mesures pour accroître la production d’uranium ; en collaborant avec ses alliés d’Europe de l’Est pour augmenter la capacité de production d’énergie nucléaire tout en réduisant sa dépendance à l’égard de la Russie ; en assurant une réglementation proactive des nouveaux réacteurs nucléaires avancés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ; et en soutenant le développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs à grande échelle, dont le premier PRM qui sera construit dans le G7 à Darlington, en Ontario.
Recommandations :
- Poursuivre le développement d’une alliance énergétique nord-américaine qui vise à maximiser la sécurité énergétique, les intérêts économiques et géopolitiques communs des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les éléments fondamentaux de l’alliance devraient inclure :
- S’engager conjointement à une politique énergétique « tout compris » qui oriente les investissements et le soutien politique des secteurs public et privé vers des projets qui renforcent la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement énergétique en Amérique du Nord. Les éléments clés devraient inclure :
- créer une chaîne d’approvisionnement énergétique robuste et résiliente dans chaque pays, renforcée par des échanges transfrontaliers d’énergie au besoin ;
- développer les exportations de GNL et d’autres énergies sur les côtes ouest et est ;
- coopérer sur les politiques relatives à l’exploitation minière et aux chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, y compris l’identification et le développement de projets d’exploitation et de transformation de minéraux critiques qui font progresser la sécurité nationale ;
- développer des chaînes d’approvisionnement nucléaire de classe mondiale pour faire baisser les prix à l’échelle nationale et créer de nouveaux marchés à l’étranger ; et
- identifier des priorités communes pour le développement et le déploiement de technologies qui renforcent la sécurité énergétique.
- Renforcer la capacité de renseignement en matière de sécurité énergétique en créant une unité spécialisée au sein du gouvernement chargée de surveiller et de recueillir des informations sur les risques et les menaces pesant sur les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement en énergie et en minéraux critiques en Amérique du Nord.
- Créer un groupe de travail réglementaire nord-américain chargé d’élaborer une vision commune pour identifier et approuver et autoriser rapidement les infrastructures qui renforcent la résilience des chaînes d’approvisionnement en énergie et en minéraux critiques de l’Amérique du Nord.
- Tirer parti de l’avantage de l’Amérique du Nord pour promouvoir les possibilités commerciales qui allient la politique d’exportation d’énergie et de minéraux critiques aux besoins des alliés et des partenaires commerciaux qui cherchent à combler leurs déficits énergétiques ou à atténuer leurs risques en matière de sécurité énergétique.
La possibilité pour le Canada d’approvisionner l’OTAN en minéraux critiques
Les risques pour les chaînes d’approvisionnement en minéraux augmentent en raison de la manipulation des prix à l’étranger, des contrôles à l’exportation et des interdictions totales, de la demande militaire croissante et des stocks limités des alliés de l’OTAN et les partenaires commerciaux. Les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni restent des importateurs nets des minéraux critiques nécessaires à leurs industries vitales, à leurs forces armées et à leurs objectifs de défense au sens large.
Les partenaires de l’OTAN sont mal préparés pour faire face aux conflits mondiaux et dépendent de la domination commerciale de la Chine et de sa forte capacité à contrôler ses exportations. Cette situation influence la capacité des membres de l’OTAN à garantir l’accès aux minéraux critiques stratégiques, notamment le bismuth, le titane, le tantale, les éléments des terres rares, le gallium, le germanium, l’antimoine, le scandium, l’indium et le graphite. Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient, les membres de l’OTAN ont besoin d’une stratégie concertée pour développer un approvisionnement sûr et sécurisé en minéraux critiques nécessaires à la sécurité nationale et à la défense.
Les pays s’empressent également de trouver des moyens d’assurer un approvisionnement stable en minéraux critiques auprès de partenaires crédibles, afin d’atteindre leurs objectifs de sécurité nationale et de défense. L’UE a récemment clôturé une consultation sur une nouvelle stratégie de stockage, signalant ainsi son intention d’aller de l’avant dans ce domaine. Les États-Unis avancent également à un rythme sans précédent pour débloquer de nouveaux approvisionnements en minéraux critiques grâce à des décrets présidentiels, des permis d’urgence et des programmes de financement ciblés supervisés par les Départements d’État et de l’Énergie, la Société financière du développement international et l’Export-Import Bank of the United States.
Le Canada est bien placé pour devenir un chef de file mondial dans la production et la transformation des minéraux critiques qui sont essentiels pour renforcer sa capacité de défense et les efforts de réarmement de ses alliés de l’OTAN. Mais, malgré son statut de grand producteur de minéraux, ses voies d’approvisionnement sécurisées vers les États-Unis et son accès aux principaux ports de la côte est et de la côte ouest, le Canada n’a pas encore manifesté son intention de créer une réserve ou un stock de minéraux critiques à des fins nationales ou pour l’OTAN.
Les marchés existants pour les métaux de niche restent opaques et immatures, ce qui pose des défis pour le Canada et ses alliés en raison de leur potentiel commercial limité. Ces défis sont exacerbés par la domination de la Chine en tant que fournisseur direct ou indirect de minéraux clés. Néanmoins, la maîtrise du Canada en matière de production et de financement miniers durables, sa compréhension des marchés mondiaux et sa structure de gouvernance stable peuvent faire du pays un fournisseur important pour les alliés de l’OTAN.
En élaborant une série d’outils visant à encourager la production canadienne de minéraux et de produits liés à la défense, y compris une réserve de minéraux critiques, le Canada peut inaugurer une nouvelle ère d’investissement dans les projets d’exploitation minière et de transformation des minéraux. Ce faisant, il rétablira sa réputation de partenaire crédible de l’OTAN et pourra soutenir la mise en place d’une base industrielle de défense qui contribuera à la réalisation de l’objectif du gouvernement en matière de dépenses militaires.
Un partenariat plus étroit avec le secteur privé est nécessaire pour libérer le potentiel du pays en minéraux critiques à des fins de défense et pour aider les partenaires de l’OTAN et les autres alliés de la défense. L’Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique et le Centre des matières premières critiques de l’UE sont des exemples de collaboration entre les secteurs public et privé visant à renforcer la sécurité nationale et économique.
Recommandations :
En tant que signataire fondateur de l’OTAN, le Canada devrait se faire le champion d’une initiative visant à créer, avec les membres de l’OTAN, une réserve de minéraux critiques pour la technologie de défense et à des fins militaires. Une telle initiative devrait :
- Créer une réserve de minéraux critiques au Canada pour les métaux de niche essentiels à des fins de défense stratégique et pour lesquels les mécanismes du marché et l’approvisionnement sont les plus fragiles. L’évaluation doit examiner attentivement les rôles et les responsabilités du gouvernement, du secteur privé et les implications pour les produits de base commercialisés sur les marchés ouverts.
- Collaborer avec l’industrie et le secteur financier afin d’encourager la production et la transformation des minéraux prioritaires au moyen d’un financement concessionnel et d’outils tels que des contrats bilatéraux et des instruments dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme standardisés et les options.
- Une telle initiative devrait permettre d’identifier les domaines dans lesquels le gouvernement peut s’engager en matière de recherche et développement et de soutien technologique afin de combler les lacunes des projets et protéger le marché contre toute ingérence de tiers.
- Consulter les nations autochtones et coopérer avec elles de bonne foi afin d’obtenir leur consentement et harmoniser les systèmes fédéraux et provinciaux d’approbation des projets et de délivrance des permis afin de faire avancer les projets d’intérêt national. Veiller à ce que les programmes d’équité et de partage des avantages offerts aux nations autochtones prévoient des fonds destinés aux projets miniers et aux infrastructures de soutien.
- Créer un instrument financier dédié aux minéraux critiques pour la défense au Canada. Un tel instrument devrait être conçu pour s’intégrer harmonieusement aux programmes existants des partenaires de l’OTAN, tels que le programme américain DPA Title 3, et en tant qu’élément du Plan d’action pour l’adhésion à l’OTAN pour les pays qui souhaitent devenir membre.
- Harmoniser les politiques commerciales des membres de l’OTAN afin d’évaluer les minéraux critiques fournis par les pays qui constituent une menace pour la sécurité nationale des membres de l’OTAN.
- Soutenir les efforts visant à évaluer les demandes et les besoins des alliés de l’OTAN et à renforcer le potentiel du Canada en tant que fournisseur de rechange dans les domaines stratégiques de la chaîne de valeur des minéraux.
Créer un processus d’approbation des projets moderne et efficace
Il existe un consensus large, non partisan et intergouvernemental sur le fait que le système canadien de réglementation et d’approbation des grands projets d’infrastructure est trop lent et trop laborieux. Loin de se contenter d’imposer des coûts aux promoteurs, un système réglementaire inefficace nuit à la compétitivité économique du Canada, à ses objectifs climatiques et à la sécurité énergétique des Canadiens et de leurs alliés.
Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l’énergie et des mines se sont engagés en mars 2025 à se concentrer sur « l’accélération de l’exploitation des ressources, en rendant les processus d’autorisation et de réglementation plus efficaces et rapides 45». Dix jours seulement après son entrée en fonction, le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles a signalé la nécessité d’une nouvelle ère de réforme des projets visant à réduire à deux ans le délai d’approbation des projets46. Peu après, les premiers ministres ont réaffirmé leur engagement à accélérer les projets d’intérêt national et à simplifier les processus d’approbation et de délivrance des permis47. Les chefs d’entreprise appuient pleinement ces ambitions.
Pourtant, d’importants défis réglementaires persistent. Le Canada doit passer des paroles à l’acte. Si ces défis ne sont pas surmontés à court terme, le Canada ne sera pas en mesure d’atteindre son objectif de regagner ou d’accroître sa part de marché mondial dans les secteurs agroalimentaire, énergétique et des minéraux critiques. Les projets sont approuvés lentement en raison de divergences entre les différents ordres de gouvernement. L’Alberta, par exemple, a annoncé en novembre 2024 son intention de soulever à nouveau la constitutionnalité de la Loi sur l’évaluation d’impact, six mois seulement après que le gouvernement fédéral ait modifié la loi suite au jugement de la Cour suprême du Canada en octobre 2023.
Le nombre de grands projets dans le domaine de l’énergie et des ressources naturelles réalisés au Canada a chuté de 37 % depuis 201548,49. La production de minéraux critiques dans certains produits de base est en baisse d’au moins 10 %, en particulier dans le secteur des métaux pour batteries, malgré les investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars consentis par les gouvernements fédéral et provinciaux dans la transformation et la fabrication en aval. Selon l’Association minière du Canada50, le Canada n’avait aucune production de lithium ou de terres rares en 2012 ni en 2022. Même lorsque les mines sont approuvées, leur mise en service prend beaucoup trop de temps : en moyenne près de 20 ans, selon S&P Global Insights51.
Les décideurs politiques canadiens doivent prendre note des mesures législatives bipartisanes en cours d’élaboration aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, qui simplifient les processus d’autorisation et accélèrent les efforts visant à faire progresser la sécurité énergétique et les objectifs climatiques. En fixant des délais maximums stricts pour l’examen des grands projets et des délais plus courts pour les litiges des projets, les États-Unis sont sur la bonne voie pour développer des processus clairs qui permettront aux entreprises d’investir et de répondre plus efficacement à la croissance des marchés énergétiques, tout en garantissant un développement responsable et efficace des ressources. Les projets qui étaient auparavant soumis à des processus d’approbation pouvant prendre des années seront désormais examinés dans un délai de 14 à 28 jours. Tout en respectant ses propres valeurs et obligations, le Canada doit être compétitif dans ce domaine.
Différents secteurs de l’économie sont confrontés à des obstacles divers en matière d’approbations et de délivrance des permis, et des réformes sont nécessaires dans de nombreux domaines. Presque toutes les parties prenantes du secteur s’accordent cependant sur la nécessité de passer au principe « un projet, une évaluation, une décision », à condition que les détenteurs de droits autochtones participent de manière significative au processus.
Le Canada est une fédération, avec toutes les possibilités et tous les défis que cela comporte. Une tendance négative a été observée, à savoir la mise en œuvre par différentes administrations de leurs propres systèmes réglementaires, souvent contradictoires, pour la réglementation des projets. Cela ajoute des coûts, de la complexité et du temps, sans apporter aucune valeur ajoutée au projet ou aux contribuables. Les provinces et le gouvernement fédéral doivent respecter leurs rôles et exceller dans la délivrance de permis et l’approbation réglementaire dans leurs domaines de compétence respectifs.
Pour éviter les chevauchements et respecter la répartition des pouvoirs prévue par la Constitution canadienne, les provinces devraient mener les évaluations environnementales des projets relevant de leur compétence, notamment les mines, les projets d’exploitation des sables bitumineux, les raffineries, les installations de production d’électricité et les pipelines intraprovinciaux. Les lignes de transport et les pipelines pancanadiens et internationaux, en revanche, devraient être évalués par la Régie canadienne de l’énergie. Les projets nucléaires devraient être évalués par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Enfin, les projets ferroviaires, les terminaux maritimes, les projets en mer et les autres projets sur les terres et les eaux fédérales qui atteignent certains seuils devraient être évalués par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.
Les organismes de réglementation fédéraux ne sont pas les seuls à devoir améliorer leurs processus. Les provinces doivent également viser l’excellence dans leurs fonctions réglementaires si le Canada veut attirer des capitaux et construire les infrastructures souhaitées par les Canadiens. Comme le montre le classement annuel de 86 administrations minières établi par l’Institut Fraser, environ la moitié des provinces et territoires sont des chefs de file mondiaux en matière de gouvernance minière, tandis que l’autre moitié est à la traîne.[52] En ce qui concerne le pétrole et le gaz, seule la Saskatchewan se classe dans la moitié supérieure du classement de l’Institut Fraser, qui évalue 17 administrations nord-américaines, tandis que l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador et la Colombie-Britannique se situent dans la moitié inférieure.[53]
Parallèlement aux projets d’approbation, le système de délivrance de permis au Canada doit être rationalisé. Certains grands projets doivent obtenir des centaines de permis auprès de multiples organismes fédéraux, provinciaux et municipaux.[54] La culture de la délivrance de permis au Canada doit changer. Les Canadiens exigent des normes élevées. Mais celles-ci doivent également être transparentes, raisonnables et concurrentielles. L’engagement récent du gouvernement fédéral de créer un nouveau bureau fédéral des grands projets est bienvenu à cet égard.
Les gouvernements canadiens ont historiquement sous-estimé la valeur que les nations autochtones apportent aux grands projets d’exploitation des ressources en tant que détenteurs de droits, intendants de l’environnement et partenaires économiques. L’intégration des droits, des intérêts et des connaissances des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les grands projets, ainsi que la garantie que les nations autochtones ont leur place à la table des discussions, peuvent accroître les chances de faire avancer les projets rapidement et à grande échelle. Sans réconciliation économique, les efforts du Canada seront certainement insuffisants. La seule façon d’aller de l’avant est d’intégrer les détenteurs de droits autochtones dans le processus.
Le Programme fédéral de garantie des prêts pour les Autochtones peut stimuler les partenariats avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits en facilitant l’accès au capital dont les groupes autochtones ont besoin pour investir dans de grands projets liés aux ressources. Après un démarrage lent, l’enveloppe de financement du programme a été portée à 10 milliards de dollars cette année. La première transaction a récemment été conclue, démontrant ainsi le potentiel du programme pour soutenir des projets d’infrastructures et de ressources naturelles essentiels. En comparaison, le Canada n’a alloué que 3,4 millions de dollars pour aider les nations autochtones à faire preuve de diligence raisonnable commerciale et à renforcer les capacités commerciales nécessaires pour favoriser des partenariats fructueux avec le secteur privé. Le Canada doit faire mieux dans ce domaine.
Il est urgent de mettre en place un système réglementaire d’approbation réglementaire efficace et moderne afin de développer les immenses ressources énergétiques et en minéraux critiques du Canada. Cela renforcera la sécurité énergétique et fera progresser les efforts de décarbonation de l’économie.
Recommandations :
- Les décideurs politiques doivent faire progresser le principe « un projet, une évaluation » dans tout le Canada et passer également à « une décision », en veillant à ce que les détenteurs de droits autochtones participent au processus.
- Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent respecter leurs domaines de compétence respectifs. Les promoteurs de projets doivent savoir qui est l’autorité de réglementation, et il ne devrait y en avoir qu’une seule.
- Les régimes d’approbation des projets du Canada devraient accorder une place importante à la participation du public, dont le rôle devrait être clair et à valeur ajoutée. Mais la portée des projets doit être appropriée et des paramètres logiques doivent être placés sur la participation du public.
- Les délais des processus réglementaires, y compris la délivrance des permis et les approbations de projets aux paliers fédéral et provincial/territorial, devraient être courts, concrets et respectés.
- Les gouvernements devraient agir rapidement pour définir des processus d’approbation plus courts pour les projets réalisés sur des friches industrielles ou dans des endroits où le promoteur a déjà obtenu un certificat environnemental ou est propriétaire d’un actif, d’une emprise ou d’un corridor existant.
- Les ressources devraient être transférées aux ministères responsables de la délivrance des permis afin d’accélérer les processus. Pêches et Océans Canada, par exemple, est responsable de l’atténuation des effets sur les poissons, les espèces aquatiques et l’habitat des poissons dans les limites de la compétence fédérale. Ses capacités devraient être renforcées afin d’accélérer la délivrance des permis.
Une vision audacieuse pour acheminer les biens vers les marchés
La capacité du Canada à répondre aux besoins de ses alliés et de ses partenaires commerciaux dépend de la résilience de son infrastructure commerciale. Comme l’a noté le Conseil sur la stratégie industrielle du gouvernement fédéral dans son rapport de décembre 2020, les investissements dans l’infrastructure commerciale et les projets similaires d’intérêt national améliorent la capacité du pays à résister aux chocs économiques, réduisent le fardeau de la dette publique et contribuent à générer les recettes fiscales nécessaires pour soutenir les programmes sociaux financés par le gouvernement.[55]
En tant que pays dépendant du commerce, le Canada doit investir de manière stratégique dans des infrastructures qui améliorent sa capacité à fournir des biens et des ressources aux marchés mondiaux. Des réseaux de transport efficaces sont indispensables pour permettre au Canada de gagner des parts de marché en tant que fournisseur de premier plan de produits de base, tels que la potasse, l’azote, les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le titane, l’or, l’aluminium et, à terme, le gaz naturel.
Malheureusement, l’infrastructure commerciale du Canada est rarement considérée comme un atout stratégique par les décideurs politiques, souffrant d’un manque d’investissement et de résultats irréguliers. Par habitant, les investissements dans les infrastructures canadiennes sont inférieurs à ceux de nombreux pays pairs, dont l’Australie, l’Espagne, la République tchèque et la Suède. Selon le Forum économique mondial et d’autres organismes, la qualité des infrastructures canadiennes est moyenne et comparable à celle de pays comme la Hongrie et l’Azerbaïdjan.[56] Les délais de traitement dans les ports du Canada sont parmi les plus longs au monde, avec une moyenne de 2,5 jours, ce qui le place au 103e rang sur 113 pays suivis par la Banque mondiale en 2023.[57]
Le Canada a besoin de toute urgence d’une stratégie nationale en matière d’infrastructure commerciale, élaborée en collaboration par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, afin de renforcer la croissance économique et d’améliorer concrètement la qualité de vie des Canadiens dans toutes les régions. Une stratégie bien définie peut contribuer à harmoniser les investissements publics dans l’infrastructure commerciale et à attirer davantage d’investissements privés. Bien structurée, une stratégie nationale peut également générer des avantages immédiats pour les fabricants du pays grâce à l’achat des biens et des matériaux nécessaires à la mise en place de chaînes d’approvisionnement solides et résilientes.
De nombreux appels en faveur d’une telle stratégie ont été ignorés par le passé. Dans son examen de la Loi sur les transports au Canada en 2015, David Emerson, l’ancien ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a demandé aux décideurs politiques d’élaborer une stratégie nationale en matière de transport des marchandises et de logistique.[58] En 2017, le Conseil consultatif en matière de croissance économique a recommandé une approche similaire. En 2023, les premiers ministres du Canada ont souligné la nécessité d’accorder la priorité aux infrastructures stratégiques et aux corridors commerciaux afin de permettre au Canada de concurrencer dans une économie mondiale et d’augmenter les possibilités de commerce international.[59]
Bien que les investissements dans l’infrastructure commerciale soient attendus depuis longtemps, le Canada ne doit pas perdre de vue le rôle essentiel que joue la connectivité dans la stimulation de l’innovation et de la technologie nécessaires pour accroître la productivité et le rendement des exploitants miniers, des producteurs agricoles et des fournisseurs d’énergie du pays. Les technologies, telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et l’informatique quantique, seront les moteurs du changement et soutiendront l’évolution du Canada vers l’agriculture de précision, la fabrication de pointe et les réseaux intelligents, qui peuvent tous être accélérés grâce à une meilleure connectivité.
Le gouvernement fédéral a également lancé une Stratégie nationale d’adaptation pour renforcer la capacité du pays à répondre aux changements climatiques. Il est important de noter que les répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus intenses et fréquents — notamment les tempêtes violentes, les inondations, les sécheresses et les feux de forêt — compromettent les corridors commerciaux vitaux du Canada. La stratégie du Canada devra mettre l’accent sur la protection des réseaux de transport contre les phénomènes météorologiques extrêmes.
Les Canadiens ont besoin d’une approche qui va au-delà des élections et des cycles budgétaires pour identifier les projets qui répondront le mieux aux besoins futurs du pays. L’Australie offre un modèle convaincant qui comprend un organisme indépendant et non partisan chargé de fournir des recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, ainsi qu’aux investisseurs et aux propriétaires d’infrastructures d’importance nationale.
Infrastructure Australia est indépendant du gouvernement fédéral et réalise des audits périodiques des infrastructures d’importance nationale du pays, élabore des plans continus sur 15 ans en matière d’infrastructure afin d’améliorer la productivité et la croissance économique, et évalue l’analyse de rentabilisation de chaque projet. L’organisme est isolé du processus politique et peut donc évaluer les besoins en infrastructures et formuler des recommandations fondées sur des critères scientifiques et économiques objectifs. Le gouvernement australien est libre d’ignorer ses conseils, mais le travail de l’organisme garantit une plus grande transparence et une plus grande responsabilité dans la prise de décision — des domaines dans lesquels l’approche du Canada en matière de planification des infrastructures laisse à désirer.
Le Fonds national des corridors commerciaux est un levier important qui peut débloquer les investissements des secteurs privé et public pour remédier aux goulets d’étranglement de longue date et aux défis de la chaîne d’approvisionnement. Les ressources allouées au fonds ont totalisé 3,8 milliards de dollars depuis sa création en 2017-18.[60] La Banque de l’infrastructure du Canada a également réalisé d’importants progrès récemment en facilitant les investissements dans les infrastructures commerciales et de transport dans le cadre de divers projets portuaires, ferroviaires et logistiques.
Bien que ces investissements soient importants, le gouvernement devrait explorer de nouvelles approches transformatrices pour investir dans l’infrastructure commerciale. L’expérience de l’Australie en matière de recyclage des actifs offre des enseignements utiles au Canada, alors que le gouvernement cherche à injecter des niveaux plus élevés de capitaux privés dans les infrastructures liées au commerce. En accordant aux États et aux territoires un délai de deux ans pour vendre ou louer leurs actifs, le gouvernement national australien a contribué à débloquer plus de 17 milliards de dollars pour de nouveaux projets d’infrastructure, notamment dans les domaines portuaire, routier, ferroviaire et du fret.
Les chaînes d’approvisionnement du Canada ont également été confrontées à des perturbations sans précédent ces dernières années en raison de barrages illégaux, de phénomènes météorologiques extrêmes et de grèves des travailleurs ferroviaires et portuaires. Le Canada a connu 62 arrêts de travail dans le seul secteur des transports en 2023 et 2024. Il est également urgent d’adopter une nouvelle approche pour protéger les chaînes d’approvisionnement du Canada contre de futures perturbations.
Le gouvernement fédéral doit avoir le pouvoir d’exercer rapidement son autorité dans des circonstances extrêmes pour empêcher les arrêts de travail qui menacent de paralyser l’économie du Canada. Cela pourrait prendre la forme d’une obligation pour les parties de se soumettre à un arbitrage obligatoire avant un arrêt de travail afin d’éviter toute perturbation des services essentiels, tels que les chemins de fer, les ports, les terminaux et autres infrastructures de transport vitales. Bien que les droits des travailleurs doivent être respectés et protégés, le gouvernement a la responsabilité d’assurer la santé économique et la sécurité de tous les Canadiens.
La loi américaine sur le travail dans le secteur ferroviaire (U.S. Railway Labor Act) établit un cadre visant à éviter toute interruption du commerce interétatique en prévoyant le règlement rapide des différends entre les transporteurs et leurs employés tout en protégeant le droit des employés à s’organiser et à négocier de manière collective. Frustrés par les interruptions répétées des chaînes d’approvisionnement du Canada, plus de 70 % des Canadiens interrogés dans un récent sondage Nanos se sont dits favorables à une intervention du gouvernement dans les conflits de travail dans les ports et les chemins de fer.[61]
Certaines parties des réseaux de transport vitaux du Canada ont également fait l’objet de barrages illégaux. Ces barrages ont provoqué d’importantes perturbations économiques et ont nui à la réputation du pays en tant que partenaire commercial fiable. En 2022, les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont dû prendre des mesures d’urgence pour faire face aux barrages aux postes frontaliers. Le Canada ne peut tout simplement pas se permettre de se porter préjudice par des barrages ou des occupations illégales de son infrastructure commerciale.
Tous les ordres de gouvernement partagent la responsabilité de veiller à ce qu’il existe l’autorité et la capacité nécessaires pour empêcher l’occupation illégale des routes et des ponts, des voies ferrées, des pipelines, des ports ou d’autres infrastructures essentielles. Ces occupations sont une question d’intérêt national et nécessitent un leadership national. La paix, l’ordre et la bonne gouvernance sont des priorités nationales. En collaboration avec les gouvernements provinciaux et municipaux, le gouvernement fédéral devrait chercher à protéger les infrastructures commerciales essentielles en établissant une autorité fédérale chargée d’intervenir en cas d’événements perturbant gravement l’économie.
Recommandations :
- Le Canada a besoin d’une stratégie nationale qui soutient l’infrastructure commerciale, notamment :
- les infrastructures physiques, les ports, les chemins de fer, les pipelines, les routes et la connectivité aux portes d’entrée et aux corridors afin de soutenir le commerce à long terme ;
- la connexion des communautés rurales aux marchés étrangers grâce à l’expansion de l’accès à la large bande afin de soutenir la numérisation des projets agricoles et liés aux ressources naturelles ; et
- la résilience face aux changements climatiques et aux menaces à la sécurité.
- Le Canada devrait s’engager publiquement à régler, par des mesures politiques ou des modifications législatives, les conflits de travail et les actes de désobéissance civile qui limitent la capacité du pays de commercer avec ses alliés et ses partenaires commerciaux.
Assurer l’avenir de l’avantage du Canada en matière de faibles émissions de carbone
Le maintien de l’avantage concurrentiel du Canada en tant qu’exportateur de produits de base à faibles émissions nécessitera une discipline et des stratégies axées sur la stimulation de la croissance. L’accès à une électricité peu dispendieuse constitue un avantage stratégique pour le Canada depuis des décennies, car il attire les investissements nécessaires à la croissance des industries des ressources naturelles, de l’énergie et de la fabrication. Alors que nos ressources énergétiques, alimentaires et en minéraux critiques peuvent contribuer à alimenter notre économie d’exportation, une électricité abordable et fiable peut servir de carte maîtresse au Canada pour attirer les investissements dans les décennies à venir.
Le réseau électrique canadien est l’un des plus propres au monde, avec environ 85 % de l’électricité provenant de sources non émettrices. Mais les marchés qui pensaient autrefois disposer d’une abondance d’électricité propre sont désormais conscients des contraintes qui pèseront sur la disponibilité future de l’énergie, ainsi que de la probabilité d’une augmentation des coûts. En effet, les politiques qui rendent plus coûteux le système électrique concurrentiel sur le plan environnemental et économique auront pour conséquence non voulue de pousser l’industrie lourde vers des administrations disposant de réseaux plus polluants, mais moins chers.
Le Canada devra au moins doubler sa capacité de production et ses infrastructures pour répondre aux besoins d’une économie qui deviendra de plus en plus dépendante d’une électricité propre, fiable et abordable, nécessaire dans une économie axée sur les données et dans un contexte d’électrification de l’industrie et des ménages à l’échelle nationale. Doubler la capacité du système nécessitera des tactiques et des approches différentes pour investir dans de nouvelles capacités, le stockage, le transport et la distribution.
Le Conseil consultatif canadien de l’électricité a souligné l’ampleur du défi à relever en matière d’investissement en estimant qu’il faudrait entre 1,1 et 2 mille milliards de dollars pour produire l’électricité supplémentaire nécessaire pour répondre à la demande prévue.[62] Des sondages récents indiquent également que les Canadiens continuent de privilégier la fiabilité et l’abordabilité plutôt que la réduction des émissions parmi leurs besoins énergétiques les plus importants pour les cinq prochaines années.[63]
Parallèlement, les réseaux électriques du Canada sont exposés à un nombre croissant de menaces liées aux cyberattaques, aux rançongiciels et aux défis en matière de sécurité posés par la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Les entreprises d’électricité canadiennes font preuve de détermination en investissant dans des mesures de sécurité et en adoptant une approche proactive pour établir des partenariats avec les gouvernements, les fournisseurs et les forums sur la sécurité conçus pour partager des informations et protéger l’infrastructure du réseau en Amérique du Nord, comme GridEx.[64]
Les possibilités d’investissement dans le secteur de l’électricité au Canada sont considérables en raison de la demande d’électricité à long terme et des déficits de production qui prévalent actuellement dans des provinces comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec.
La construction d’un réseau de transport est-ouest plus intégré présente une grande valeur pour encourager la coordination interprovinciale et les échanges commerciaux d’électricité. Le gouvernement fédéral a fait part de son intention d’encourager des niveaux d’investissement plus élevés en accordant des crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et les technologies connexes, tandis que le mandat récemment élargi de la Banque de l’infrastructure du Canada, qui consiste à investir dans des projets de production d’électricité, est utile à cet égard. Ces mécanismes de financement, parmi d’autres, peuvent renforcer la position dominante du Canada en matière d’électricité à l’échelle nationale.
Mais les gouvernements provinciaux font face à des déficits plus importants et à des coûts d’emprunt plus élevés, le déficit provincial global devant atteindre son plus haut niveau depuis 2013, hors années de pandémie. À l’inverse, les fonds de pension et les fonds d’investissement privés disposent d’importantes réserves de capitaux à la recherche des rendements stables que peuvent offrir les marchés de l’électricité. Mais seule l’Alberta, et dans une moindre mesure l’Ontario, disposent des marchés nécessaires pour soutenir les investissements dans l’approvisionnement en électricité.
Même si la production, le transport et la distribution d’électricité relèvent en grande partie de la compétence des provinces et des municipalités, tous les ordres de gouvernement doivent collaborer à l’élaboration du réseau électrique de demain. Cela devrait inclure une compréhension commune des meilleures options pour accroître la capacité d’électricité et décarboner chaque région, ainsi que des échéanciers réalistes tenant compte des coûts et des répercussions potentielles pour les consommateurs. Ce type de collaboration, y compris avec les partenaires autochtones, garantira des investissements opportuns dans la production et le transport d’électricité propre, ce qui permettra de maintenir la compétitivité de l’industrie canadienne dans les décennies à venir.
Recommandations :
- Le gouvernement fédéral devrait promouvoir un effort national axé sur la réalisation d’un double mandat en matière de production d’électricité et de sécurité du réseau. Toutes les provinces et tous les territoires devraient être encouragés à élaborer des voies technologiques assorties de stratégies d’investissement pour produire, stocker, transporter et distribuer une électricité fiable, abordable et propre aux Canadiens. Un meilleur partage de l’information sur les prévisions de la demande en électricité et les stratégies d’investissement peut déterminer le soutien fédéral dans les domaines relevant de la compétence des provinces.
- Ces efforts devraient également inclure une attention proactive au renforcement de la sécurité et de la résilience des réseaux électriques canadiens face aux menaces liées à la cybersécurité et aux risques naturels.
- Les initiatives devraient :
- Construire et renforcer les connexions interprovinciales de transport d’énergie afin de créer de nouveaux marchés de l’énergie et d’améliorer la fiabilité et la sécurité énergétiques.
- Mettre l’accent sur l’interdépendance de la production, du transport et de la distribution d’électricité, y compris les menaces.
- Se concentrer sur la sécurité et la résilience du réseau afin de garantir une disponibilité suffisante pour produire de l’électricité en fonction de la demande lorsque les énergies renouvelables ne sont pas disponibles.
- Faciliter l’échange d’informations entre les provinces sur la demande d’électricité prévue en fonction des tendances de consommation, de la composition industrielle, des perspectives économiques et des objectifs de décarbonation.
- Développer des technologies visant à minimiser les goulets d’étranglement et les retards dans la chaîne d’approvisionnement en soutenant des stratégies d’approvisionnement axées sur la maturité technologique et la réduction des coûts pour les contribuables.
- Évaluer le développement de la main-d’œuvre, les compétences et le bassin de main-d’œuvre nécessaires pour renforcer la capacité de production d’électricité dans diverses administrations du pays.
Redynamiser les relations canado-américaines dans le domaine de l’électricité
e Canada et les États-Unis disposent de l’un des réseaux électriques les plus intégrés au monde, avec environ 1500 kilomètres de lignes de transport fournissant une électricité fiable, sûre et abordable aux citoyens des deux pays. Les provinces canadiennes riches en hydroélectricité et l’approvisionnement nucléaire de l’Ontario ont toujours fait du Canada un exportateur net d’électricité vers les États-Unis.
Mais les hivers anormalement doux, les conditions de sécheresse croissantes et l’augmentation de la demande d’électricité au Canada mettent à rude épreuve la quantité d’électricité disponible à l’exportation. Les exportations du Canada vers les États-Unis ont fortement chuté en 2023, atteignant leur niveau le plus bas depuis 201065. À l’inverse, les importations d’électricité en provenance des États-Unis atteignent un pic, les exportations nettes des États-Unis vers la Colombie-Britannique étant parmi les plus élevées de l’histoire récente66.
Signée en 2016, la Stratégie conjointe sur la sécurité et la résilience du réseau électrique entre les États-Unis et le Canada est une collaboration entre les États-Unis et le Canada visant à renforcer la sécurité et la résilience de leur réseau électrique commun. Peu après avoir pris cet engagement, le Canada a produit en 2016 un plan d’action sur la sécurité et la résilience du réseau, qui n’a toujours pas été mis à jour.
Recommandations :
- Le Canada devrait redynamiser son accord avec les États-Unis et présenter un plan d’action axé sur la résilience du réseau, le commerce transfrontalier de l’électricité et la sécurité. Le plan doit :
- Améliorer le partage d’informations sur les demandes d’électricité prévues sur les marchés régionaux qui pourraient bénéficier d’une intensification des échanges commerciaux entre les deux pays.
- Poursuivre les plans d’infrastructure à long terme qui identifient les projets visant à renforcer ou à élargir le corridor électrique canado-américain et trouver des moyens de rationaliser le processus d’approbation des infrastructures transfrontalières afin de garantir son efficacité, sa prévisibilité et la prise de décisions en temps opportun.
- Réaffirmer le soutien du Canada à l’évaluation de la sécurité transfrontalière de l’approvisionnement en électricité en collaborant avec ses homologues américains pour évaluer les forces et les faiblesses des infrastructures existantes ; améliorer la capacité de chaque pays à réagir aux menaces et aux incidents causés par des entités étrangères et des risques naturels.
Une approche axée sur le marché pour réduire les émissions industrielles
En juin 2024, 82 % des émissions mondiales étaient couvertes par un engagement envers la carboneutralité. Ce chiffre devrait être inférieur de 10 % lorsque les États-Unis se retireront de l’Accord de Paris en 2026. Néanmoins, les émissions par habitant sont en baisse dans la plupart des marchés d’exportation qui importent des produits canadiens, ce qui indique une demande pour des produits et de l’énergie à plus faibles émissions.
La politique climatique du Canada devrait évoluer pour soutenir les entreprises en concurrence sur des marchés qui accordent une importance à la teneur en carbone des biens produits ou importés sur leur territoire. L’Union européenne a introduit en 2023 le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour certaines industries lourdes, comme le ciment, le fer, l’acier et l’aluminium, tandis que plusieurs partenaires commerciaux du Canada, tels que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, le Royaume-Uni et le Brésil, ont signalé leur intention d’introduire des politiques similaires à l’avenir.
Le soutien se renforce également aux États-Unis, où des sénateurs républicains ont récemment présenté un plan commercial et industriel visant à répondre aux préoccupations économiques et de sécurité nationale en imposant des taxes sur les biens importés en fonction de leur intensité en carbone.[67] Le Canada devra agir rapidement pour définir sa stratégie dans un nouvel ordre mondial prêt à protéger les industries nationales et à privilégier la réduction des émissions de carbone.
Les décideurs politiques devraient examiner la manière dont les politiques d’ajustement carbone aux frontières influenceront le rendement du Canada en matière d’émissions et leur importance stratégique pour atteindre l’objectif du pays de bâtir l’économie la plus prospère du G7. Le gouvernement fédéral peut prendre de nombreuses mesures pour s’assurer que les partenaires commerciaux du Canada reconnaissent la valeur des exportations à faibles émissions de carbone du pays et le rôle qu’elles peuvent jouer dans la réduction des GES à l’échelle mondiale. Il existe des arguments convaincants pour démontrer que les politiques en matière de carbone et les normes environnementales du Canada sont déjà parmi les plus strictes au monde, et que ses exportations devraient donc être exemptées des mesures d’ajustement carbone aux frontières mises en place par ses partenaires commerciaux.
Pour stimuler la croissance et rétablir l’équilibre budgétaire grâce à l’augmentation du commerce des ressources, les décideurs politiques devront trouver un équilibre entre les objectifs liés à la réduction des émissions et la nécessité pour les entreprises d’être compétitives sur les marchés mondiaux à la recherche de produits à faibles émissions.
Les chefs d’entreprise s’inquiètent de la trajectoire de la politique climatique du Canada. Les entreprises sont contraintes d’évoluer dans un environnement réglementaire complexe et dense, qui comprend de multiples exigences réglementaires et programmes visant à encourager des niveaux d’investissement plus élevés. Les principales mesures politiques, notamment le Règlement sur l’électricité propre, les nouvelles réglementations sur le méthane et le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz, obligeront les entreprises à attendre que la situation politique soit clarifiée avant de déterminer la meilleure façon d’investir les fonds de leurs actionnaires dans leurs activités. Les nouvelles dispositions relatives aux déclarations environnementales et à l’écoblanchiment ont accru la complexité pour les entreprises qui souhaitent commercialiser leurs produits à faibles émissions à l’étranger. Dans de nombreux cas, le rythme et la fréquence des nouvelles mesures politiques et réglementaires vont à l’encontre des programmes et incitations du gouvernement visant à accélérer les investissements dans la technologie et l’innovation.
La tarification du carbone reste une incitation efficace et puissante pour l’industrie à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité et à réduire les émissions.[68] La tarification du carbone dans l’industrie s’est révélée être une incitation efficace à la mise en œuvre de nouvelles technologies permettant aux entreprises de produire des produits à faible intensité de carbone.
Depuis 2019, toutes les administrations du Canada ont fixé un prix pour la pollution par le carbone provenant des émetteurs industriels, et la plupart des provinces et des territoires ont mis en place des systèmes pour les émissions industrielles produites sur leur territoire. Depuis l’entrée en vigueur du système national, il y a environ cinq ans, des études ont montré que la tarification des émissions industrielles pourrait permettre de réduire les émissions au Canada de 20 à 48 % d’ici à 2030.[69] Les données montrent également qu’un signal de prix ne suffit pas à lui seul ; il doit être accompagné de politiques économiques favorables pour décarboner rapidement les activités industrielles et aider les entreprises à demeurer concurrentielles à l’avenir.
Le gouvernement fédéral a mis en place une série de crédits d’impôt pour encourager des niveaux d’investissement plus élevés dans les technologies émergentes, tandis qu’environ 50 milliards de dollars sont disponibles dans le cadre du Fonds de croissance du Canada et de la Banque de l’infrastructure du Canada pour des projets visant à réduire les émissions. Pourtant, la portée et l’ampleur des investissements nécessaires restent considérables : pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, il faudrait investir 2 000 milliards de dollars, mais les niveaux d’investissement d’une année sur l’autre sont encore loin du compte. Ils doivent être multipliés par 5,5 à 8,5 par rapport à leur niveau actuel.[70]
Une politique claire et une tarification stable des émissions industrielles de carbone sont essentielles pour permettre une approche axée sur le marché en vue de financer des projets de décarbonation à grande échelle.
Parallèlement, une part importante du commerce du Canada est liée à l’extraction, à la production et à la transformation des ressources naturelles. Compte tenu de la nature intrinsèquement énergivore de son économie fondée sur les ressources naturelles, les décideurs politiques du Canada ne peuvent pas perdre de vue le besoin urgent de renforcer la capacité économique du pays en augmentant le commerce des ressources, tout en obtenant des résultats environnementaux positifs qui favorisent une économie résiliente et innovatrice.
Les politiques qui utilisent les signaux de prix pour modifier les comportements doivent ajuster avec soin les niveaux de prix et de rigueur afin d’empêcher les entreprises de se délocaliser vers des pays où la réglementation est moins stricte. Le gouvernement fédéral doit veiller à ce qu’aucun désavantage régional ou sectoriel ne rende les entreprises moins concurrentielles par rapport à leurs rivales mondiales. En outre, les réductions d’émissions devraient provenir d’investissements dans les technologies de réduction du carbone, et non de la désindustrialisation. Il sera essentiel pour le Canada de trouver cet équilibre.
Alors que le Canada cherche à revitaliser son économie en développant de nouvelles capacités d’exportation vers divers marchés, les décideurs politiques doivent résister à la tentation d’élaborer de nouvelles réglementations visant à réduire les émissions à l’heure actuelle. Le gouvernement devrait plutôt procéder à un examen complet des politiques, des règlements et des programmes afin de garantir la mise en place d’un cadre politique clair et cohérent pour réduire les émissions et soutenir la compétitivité des entreprises canadiennes dans une économie à faibles émissions de carbone. Cet examen devrait chercher à identifier les marchés où les exportations à faible teneur en carbone du Canada peuvent réduire les émissions mondiales.
Recommandations :
- Améliorer les programmes de tarification du carbone de l’industrie canadienne en :
- examinant le calendrier de mise en œuvre du prix minimum sur le carbone industriel et les normes d’émissions et les niveaux de rigueur correspondants afin d’évaluer leur incidence sur l’économie, la sécurité énergétique et les industries à forte intensité d’émissions et dépendantes du commerce du Canada. L’objectif de cet examen devrait être de prévenir les fuites de carbone et de veiller à ce que les entreprises dépendantes du commerce puissent rivaliser avec leurs homologues mondiaux ;
- augmentant rapidement le nombre de protocoles de compensation offerts à l’industrie, y compris les engagements existants visant à élaborer de nouveaux protocoles pour le captage direct dans l’air, les émissions de méthane, l’aménagement forestier et la séquestration du carbone dans le sol ;
- veillant à ce que les revenus générés par les programmes de tarification soutiennent le développement de nouvelles technologies et les investissements dans les installations génératrices d’émissions ; et
- favorisant les synergies entre les marchés existants grâce à la création de crédits et à des possibilités d’échange de droits d’émission au Canada.
- Le Canada devrait agir rapidement pour commercer avec des pays aux vues similaires qui partagent les mêmes priorités :
- les chaînes de valeur à faibles émissions de carbone dans les domaines de l’alimentation, des minéraux critiques et de la sécurité énergétique ;
- la réduction d’émissions grâce à des politiques climatiques comparables dans les secteurs industriels les plus difficiles à décarboner ; et
- la dissuasion des pays qui profitent du système en appliquant des réglementations moins strictes en matière de GES.
Stimuler l’innovation et les technologies performantes
La possibilité pour le Canada de se démarquer comme une solution aux défis mondiaux en matière d’énergie et de sécurité alimentaire devrait aller au-delà de l’exportation de produits de base bruts et non transformés. L’exploitation des ressources naturelles du Canada pourrait créer une occasion unique pour notre génération de stimuler le progrès technologique, d’accroître la productivité et de développer des ressources tout en réduisant au minimum les émissions. L’innovation sera également essentielle pour combler les lacunes en matière de main-d’œuvre et de compétences dans les secteurs de l’économie fondée sur les ressources, tels que l’agriculture et l’exploitation minière.
Le Canada possède une expertise de calibre mondial dans les domaines de l’agriculture, de l’exploitation minière et des systèmes énergétiques. Mais les idées et les technologies performantes n’atteignent souvent pas le stade de la commercialisation. Cela doit changer. Le Canada doit mieux exploiter les résultats de la recherche et du développement novateurs pour les transformer en applications commerciales.
Une approche axée sur l’innovation présente un potentiel impressionnant. Dans le secteur de l’agriculture, un rapport publié par l’Arell Food Institute a révélé que les innovations émergentes en matière de technologies agricoles peuvent permettre de réaliser des gains d’efficacité et de productivité suffisants pour générer des possibilités d’une valeur de 30 milliards de dollars pour le Canada.[71] Cela permettrait au Canada de s’établir comme un chef de file mondial dans le domaine de l’agriculture durable, du développement des technologies agricoles et de la sécurité alimentaire au pays et à l’étranger.
Des arguments similaires peuvent être avancés pour les industries énergétiques et minières, qui comptent un grand nombre d’entreprises dont les portefeuilles de propriété intellectuelle (PI) et de données d’IA sont proportionnellement faibles et qui expédient des produits bruts destinés à être raffinés et améliorés ailleurs. Le Canada est actuellement un importateur net de PI, une position qu’il partage avec les pays en développement.[72]
Cependant, les investissements dans la recherche et le développement doivent être considérablement renforcés. En pourcentage du PIB, les dépenses publiques et privées combinées du Canada en R&D sont en baisse depuis 2001.[73] Les États-Unis investissent actuellement 2,9 % de leur PIB dans la R&D, le département de l’Énergie (Department of Energy) recevant à lui seul 2 milliards de dollars américains pour renforcer la capacité du pays à mener des activités scientifiques et de recherche transformatrices dans des technologies de pointe. Le Canada investit 1,57 %, soit nettement moins que la moyenne de l’OCDE. Les investissements publics et privés en R&D doivent augmenter. Les entreprises sont désireuses d’investir davantage, mais elles ont besoin d’un partenaire volontaire au sein du gouvernement fédéral pour les aider à éliminer les risques liés aux investissements dans les technologies émergentes, à remédier aux défaillances du marché et à améliorer le bien-être social.
Les investissements en capital de risque du Canada, exprimés en pourcentage du PIB, se situent dans la moyenne de l’OCDE. Le pays éprouve également des difficultés à transformer la recherche en solutions commerciales, se classant derrière la Chine et les États-Unis en matière de commercialisation de brevets par habitant. Il en résulte que les investissements du Canada dans les sciences et la technologie ne produisent pas d’innovations au même rythme que ceux de ses pairs. Nous devrions aspirer à faire mieux.
Les engagements visant à améliorer les relations de travail entre le gouvernement fédéral et le secteur privé afin de stimuler l’innovation n’ont pas encore été tenus ou peinent à produire des résultats concrets. La décision prise l’an dernier de reporter à 2026-2027 la création de la nouvelle Société canadienne de l’innovation et la décision récente de rattacher Technologies du développement durable Canada au Conseil national de recherches ont limité la capacité du secteur privé à collaborer avec le gouvernement à la recherche de pointe et à créer un avantage concurrentiel pour les entreprises canadiennes grâce à des technologies commerciales. Les cadres réglementaires du Canada devront suivre le rythme de l’innovation afin que les entreprises puissent utiliser un éventail de technologies pour améliorer l’efficacité et la sécurité de leurs activités.
Un récent rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable a également constaté que l’initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l’innovation — le programme phare de financement de l’innovation du gouvernement, doté de 8 milliards de dollars — n’est pas liée à une politique industrielle cohérente et globale visant à réduire les émissions produites par les industries les plus critiques du Canada.[74] Collectivement, ces lacunes illustrent la nécessité réelle de reconstruire l’architecture de l’innovation au Canada.
Il est nécessaire de créer une nouvelle agence gouvernementale chargée de stimuler la technologie, l’innovation et la compétitivité économique. Cette agence s’attacherait à améliorer le transfert de technologies de la recherche publique vers les entreprises canadiennes dans des secteurs tels que l’énergie, l’exploitation minière, l’agroalimentaire et les secteurs clés, tels que les transports. Son objectif principal devrait être d’encourager la recherche appliquée en renforçant la collaboration entre l’industrie, le monde universitaire et le gouvernement.
Advanced Research Projects Agency for Energy (ARPA-E) des États-Unis, Emissions Reductions Alberta et le Centre for Innovation and Clean Energy de la Colombie-Britannique offrent tous des modèles de réussite à prendre en considération. Une agence d’innovation forte et crédible peut également permettre au Canada de mieux établir des partenariats et collaborer de manière significative avec ses pairs internationaux sur des initiatives importantes concernant les technologies de la prochaine génération, telles que l’énergie géothermique de base, les systèmes de stockage de l’énergie et l’innovation nucléaire.
Recommandations :
- Créer une agence fédérale de projets de recherche avancée pour stimuler le progrès technologique, l’innovation et la compétitivité économique.
- Une telle agence devrait être chargée d’assurer un meilleur transfert des technologies entre la recherche financée par les fonds publics et les entreprises canadiennes qui pourraient commercialiser ces idées. Des programmes spécialisés devraient être créés pour les industries à forte valeur ajoutée axées sur l’exportation, telles que l’agroalimentaire, l’énergie et les minéraux critiques.
- La nouvelle agence devrait être dotée d’une fonction d’approvisionnement qui lui permette d’investir dans la recherche et le développement à haut risque et à haut rendement, ainsi que dans les technologies issues de la collaboration de l’agence avec le secteur privé.
Conclusion
Le Canada dispose d’une occasion unique. En tant que démocratie stable dotée d’abondantes ressources énergétiques et naturelles, d’une main-d’œuvre talentueuse et de marchés financiers solides, le Canada pourrait devenir une puissance mondiale dans le domaine de l’énergie et des ressources naturelles. Grâce à ces avantages, le Canada est en mesure d’accroître sa capacité économique et de répondre aux besoins de ses alliés et partenaires commerciaux qui recherchent un approvisionnement sûr en énergie, en denrées alimentaires et en minéraux critiques.
Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient, les décideurs canadiens doivent assurer la réussite du Canada dans un nouvel ordre mondial de plus en plus façonné par les priorités économiques et de sécurité. Une progression graduelle ne devrait pas être l’objectif. Le Canada devrait plutôt poursuivre une vision de l’avenir où l’accroissement de la part de marché mondial dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles se traduit par une qualité de vie élevée pour les Canadiens et fait du pays une destination stable pour les capitaux à long terme qui valorisent les rendements d’un développement responsable des ressources.
Le Canada peut renforcer sa souveraineté économique et jouer un rôle essentiel dans la résolution des défis mondiaux liés à l’énergie, à l’alimentation et à la sécurité nationale. Cependant, il dispose d’une marge de manœuvre limitée pour reconstruire son économie et rétablir sa position mondiale en tant que fournisseur majeur des produits de base dont le monde a besoin. Les alliances mondiales se reconstituent, obligeant les pays à agir rapidement pour s’approvisionner en ressources auprès de fournisseurs fiables.
Une stratégie d’exportation audacieuse et transformatrice est nécessaire pour permettre au Canada de retrouver sa position de chef de file mondial, de prospérer sur les marchés internationaux et de rétablir sa réputation de nation commerçante fiable. Cette stratégie nécessite de véritables partenariats entre les secteurs public et privé et un cadre politique cohérent et ambitieux conçu pour garantir les investissements sur plusieurs décennies.
Le Canada doit agir maintenant.
Footnotes
[1] Disponible à l’adresse : https://www.banqueducanada.ca/2024/03/heure-sonne-reglons-probleme-productivite-canada/
[2] Disponible à l’adresse : https://www.oecd.org/en/publications/the-long-game-fiscal-outlooks-to-2060-underline-need-for-structural-reform_a112307e-en.html
[3] Disponible à l’adresse : https://economics.td.com/fr-provincial-economic-forecast
[4] Disponible à l’adresse : https://ppforum.ca/publications/don-wright-middle-class/
[5] Ibid.
[6] Disponible à l’adresse : https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/growing-debt-burden-for-canadians-2024.pdf
[7] AIE. Global Critical Minerals Outlook 2025. Disponible à l’adresse : https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025
[8] Source : https://www.iea.org/topics/critical-minerals
[9]Source : https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/outlook-for-battery-demand-and-supply
[10]HSBC Global Research. The Future of Food: Can we Meet the Needs of 9B People? https://www.research.hsbc.com/C/1/1/320/WgCK7Wv#:~:text=As%20of%202023%2C%20roughly%2010,possibly%20by%2070%25%20by%202050
[11]Source : https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/global_health-sante_mondiale/food_assistance-assistance_alimentaire.aspx?lang=fra
[12]Source : https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100
[13]RBC, 2025. L’alimentation d’abord : Comment le secteur agricole peut ouvrir la voie à une nouvelle ère d’exportation canadienne. Disponible à : https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100
[14] ExxonMobil Global Outlook, 2024. Disponible à l’adresse : https://corporate.exxonmobil.com/sustainability-and-reports/global-outlook#Keytakeaways
[15]AIE, World Energy Outlook 2023. Disponible à l’adresse : https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
[16]Source : https://www.reuters.com/business/energy/ceraweek-iea-director-birol-says-there-is-need-investment-existing-oil-gas-2025-03-10/
[17]Source : https://www.csis.org/analysis/mining-defense
[18] Source : https://www.economist.com/graphic-detail/2023/05/10/expensive-energy-may-have-killed-more-europeans-than-covid-19-last-winter
[19] https://www.cyber.gc.ca/sites/default/files/cybermenaces-contre-secteur-petrolier-gazier-canada-f.pdf
[20] Source : https://www.iea.org/news/sharp-declines-in-critical-mineral-prices-mask-risks-of-future-supply-strains-as-energy-transitions-advance
[21] https://www.foreignaffairs.com/ukraine/food-weaponization-makes-deadly-comeback
[22] Source : Université d’Ottawa, programme Énergie positive, 2025. Diapositive 13. Disponible à l’adresse : https://www.uottawa.ca/research-innovation/sites/g/files/bhrskd326/files/2025-03/Positive%20Energy%20January%202025%20OMNI%20Survey.pdf
[23] Source : https://ressources-naturelles.canada.ca/science-donnees/donnee-analyse/inventaire-grands-projets
[24] Institut climatique du Canada, 2024. Des progrès évidents : les émissions du Canada sont plus basses qu’avant la pandémie, ce qui démontre une séparation claire entre croissance économique et émissions.
[25] Disponible à l’adresse : https://www.spglobal.com/content/dam/spglobal/global-assets/en/special-reports/lng-study/USLNGImpactStudy_Phase%202%20SummaryPresentation_.pdf
[26] Disponible à l’adresse : https://foodsustainability-cms.eiu.com/country-ranking/
[27] RBC, 2022. Agriculture, Technology, and the Path to Net Zero. Disponible à l’adresse : https://www.rbccm.com/en/insights/story.page?dcr=templatedata/article/insights/data/2022/09/agriculture-technology-and-the-path-to-net-zero
[28] Source : https://gifs.ca/sustainableag
[29] Source : https://www.canadianminingjournal.com/featured-article/canadas-edge-in-the-race-to-decarbonization/
[30] Source : https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/12/Introducing-Skarn-October-2021.pdf
[31] Source : BMO. Avril 2025. I Want What You Got: Canada’s Oil Resource Advantage.
[32] Ibid.
[33] Source : https://www.iea.org/reports/the-role-of-gas-in-todays-energy-transitions
[34] Source : https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2025/key-findings
[35] Source : https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2021/11/Efficacit%C3%89Climatique-PPF-Oct2021-FR1.pdf
[36] Source : https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2021/11/Efficacit%C3%89Climatique-PPF-Oct2021-FR1.pdf
[37] Source : https://international.canada.ca/fr/affaires-mondiales/organisation/transparence/rapports-publications/economiste-chef/point-commerce/2024
[38] Source : https://albertacentral.com/intelligence-centre/economic-news/the-lost-decades-or-how-the-oil-boom-masked-canadas-economic-mediocrity/
[39] Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240509/cg-a001-fra.htm
[40] Source : RBC, 2025. L’alimentation d’abord : Comment le secteur agricole peut ouvrir la voie à une nouvelle ère d’exportation canadienne. Disponible à l’adresse : https://www.rbc.com/fr/leadership-avise/lalimentation-dabord-comment-le-secteur-agricole-peut-ouvrir-la-voie-a-une-nouvelle-ere-dexportation-canadienne/
[41] Disponible à l’adresse : https://peacediplomacy.org/2023/09/12/canada-has-lost-its-purpose-in-foreign-relations-its-time-for-a-review/
[42] Matthew Andrea et Rene Santos, 2021. Spotlight : Oil Project Sanctioning Is Picking Up on the back of Higher Oil Prices. S&P Global. Disponible à l’adresse : https://www.spglobal.com/commodityinsights/pt/market-insights/latest-news/oil/062321-spotlight-oil-project-sanctioning-is-picking-up-on-the-back-of-higher-oil-prices
[43] Source : https://ressources-naturelles.canada.ca/source-energie/combustibles-fossiles/projets-canadiens-gnl-canada
[44] https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=64844
[45] Déclaration disponible à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2025/03/declaration-conjointe-des-ministres-de-lenergie-et-des-mines-du-canada.html
[46] Source : https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2025/05/discours-du-ministre-tim-hodgson-devant-la-chambre-de-commerce-de-calgary.html
[47] Disponible à l’adresse : https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/declarations/2025/06/02/declaration-des-premiers-ministres-du-canada-des-provinces-et-des-territoires
[48] Disponible à l’adresse : https://thehub.ca/2024/05/02/heather-exner-pirot-the-collapse-in-energy-and-resource-investment/
[49] Disponible à l’adresse : https://ressources-naturelles.canada.ca/science-donnees/donnee-analyse/inventaire-grands-projets
[50] Disponible à l’adresse : https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/06/Facts-and-Figures-2023-FINAL-DIGITAL.pdf
[51]Disponible à l’adresse : https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/from-6years-to-18years-the-increasing-trend-of-mine-lead-times
[52] Disponible à l’adresse : https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2023#:~:text=The%20top%20jurisdiction%20in%20the,Arizona%20(7th)%2C%20Northern%20Territory
[53] Disponible à l’adresse : https://www.fraserinstitute.org/studies/canada-us-energy-sector-competitiveness-survey-2023
[54] Disponible à l’adresse : https://www.miningillustrated.ca/work/2020/11/17/ontario-permitting-process
[55] Disponible à l’adresse : https://ised-isde.canada.ca/site/innover-meilleur-canada/fr/conseil-strategie-industrielle/redemarrer-relancer-repenser-prosperite-tous-canadiens
[56] Canada West Foundation, 2022. From Shovel Ready to Shovel Worthy. Disponible à l’adresse : https://cwf.ca/wp-content/uploads/2022/05/CWF_ShovelReadytoShovelWorthy_Report_WEB.pdf
[57] RBC, 2024. Le défi de la croissance au Canada : pourquoi l’économie est au point mort. Disponible à l’adresse : https://leadershipavise.rbc.com/wp-content/uploads/Canadas-Growth-Challenge-Report-FR.pdf
[58] Source : Examen de la Loi sur les transports au Canada, 2015. Parcours : brancher le système de transport du Canada au reste du monde.
[59] Source : Conseil consultatif en matière de croissance économique, 2017. Favoriser la productivité par l’entremise de l’infrastructure.
[60] https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_202403_04_f_44453.html
[61] https://nanos.co/canadians-are-over-three-times-more-likely-to-prefer-that-the-federal-government-intervene-in-the-case-of-a-port-or-railway-labour-dispute-rather-than-allow-a-possible-disruption-nmg-nanos-research/
[62] https://ressources-naturelles.canada.ca/source-energie/l-avenir-electrique-canada-plan-reussir-transition
[63] https://nanos.co/wp-content/uploads/2024/05/2024-2551-MLI-Energy-Conference-Populated-report-Updated.pdf
[64] Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.nerc.com/pa/CI/ESISAC/Pages/GridEx.aspx
[65] U.S. Energy Information Administration, 2024. Disponible à l’adresse : https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=63684
[66] Ibid.
[67] Disponible à l’adresse : https://www.cassidy.senate.gov/newsroom/press-releases/cassidy-graham-introduce-latest-version-of-trade-manufacturing-policy-to-hold-china-accountable/
[68] Disponible à l’adresse : https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl6547
[69] Disponible à l’adresse : https://institutclimatique.ca/news/une-nouvelle-analyse-montre-que-la-tarification-du-carbone-industriel-est-le-principal-facteur-de-reduction-des-emissions/
[70] Disponible à l’adresse : https://www.rbc.com/fr/leadership-avise/recherche-economique/logement-au-canada/accessibilite-a-la-propriete/une-transition-a-2-billions-de-dollars/
[71] Disponible à l’adresse : https://arrellfoodinstitute.ca/wp-content/uploads/2024/10/Ag-tech-Strategy-Report-Screen-revised-Oct-8.pdf
[72] Disponible à l’adresse : https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/renseignements-organisationnels/balados-voix-pi-canadienne-etudes-cas-blogue/regard-presence-canada-dans-monde-pi
[73] Asselin, 2022. Growth, Innovation and the Organization of Science Policy in Canada. Disponible à l’adresse : https://ppforum.ca/publications/growth-innovation-and-the-organization-of-science-policy-in-canada/
[74] https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202404_04_f_44471.html