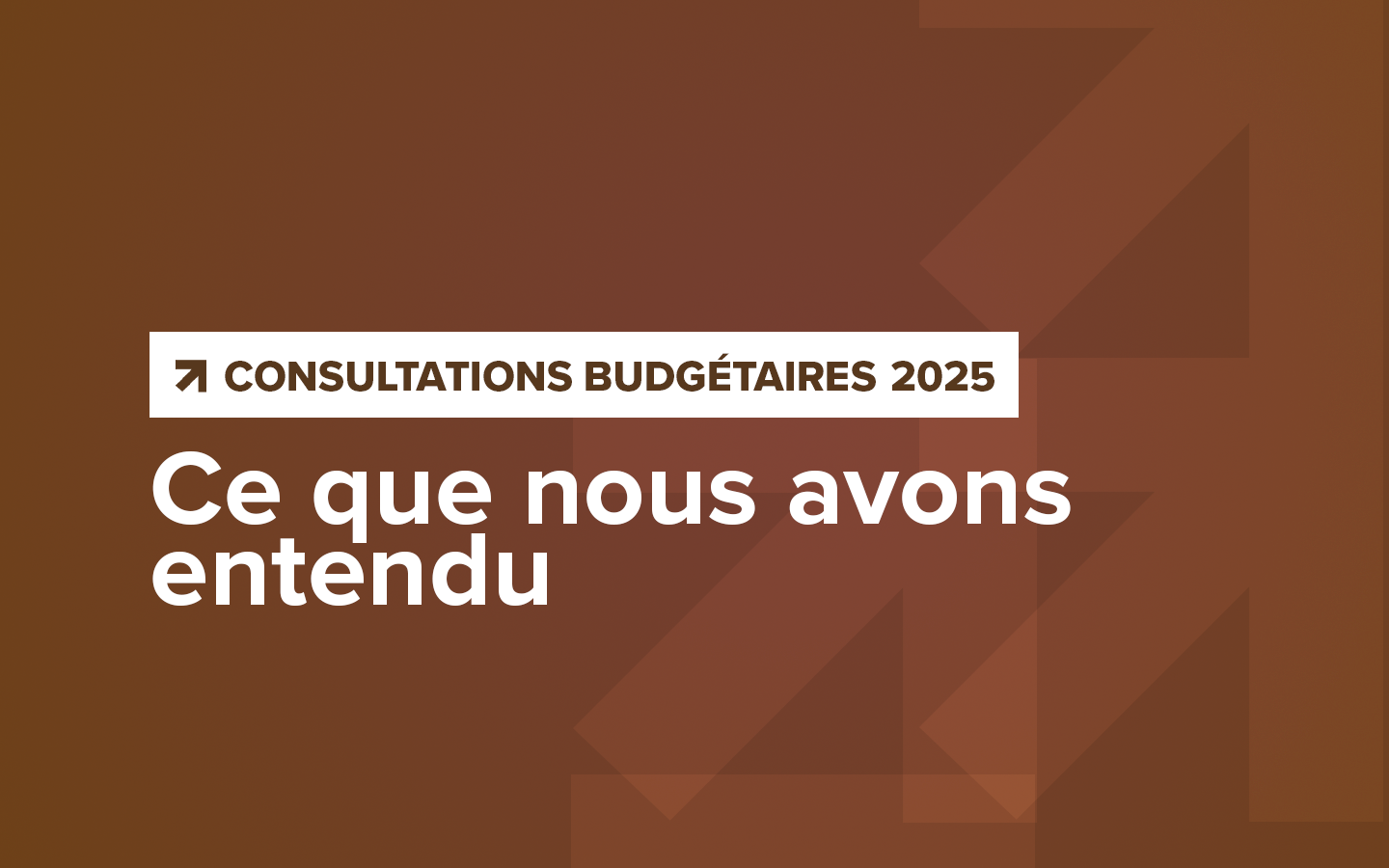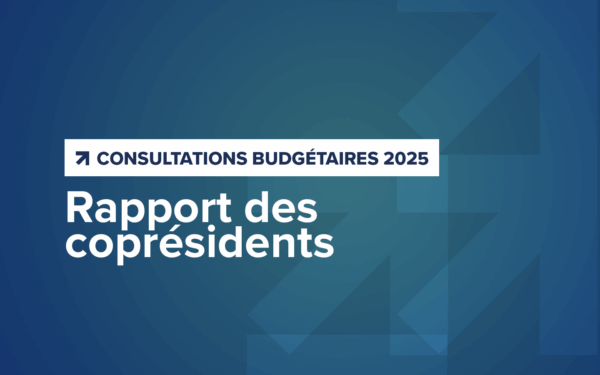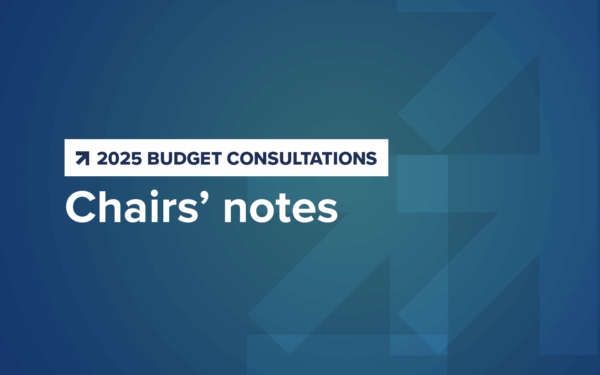Ce que nous avons entendu
Consultations budgétaires 2025
Le Canada est actuellement soumis à de fortes contraintes budgétaires : augmentation de l’encours de la dette, hausse des taux d’intérêt, ralentissement de la croissance mondiale et pressions structurelles croissantes. L’économie s’adapte à une économie mondiale fragmentée qui réduit l’accès au marché américain et alimente l’incertitude en matière d’investissement.
Le 4 novembre, le gouvernement du premier ministre Mark Carney fera le point sur la trajectoire budgétaire, prendra de nouveaux engagements et apportera des changements à son approche en matière de planification budgétaire. Tout indique que les déficits seront beaucoup plus élevés au cours des deux prochaines années, et le gouvernement semble déterminé à continuer de creuser les déficits indéfiniment afin de soutenir une économie qui commence déjà à ressentir le poids des droits de douane américains.
Dans ce contexte, le Conseil canadien des affaires (CCA) a mené une vaste consultation sur l’avenir de la politique budgétaire du pays.
Un certain nombre de thèmes clés sont ressortis de la consultation. Voici ce que nous avons entendu.
(Divulgation : nous avons utilisé de grands modèles linguistiques pour aider à synthétiser les réponses.)
1) État des finances fédérales
L’un des points sur lesquels notre enquête fait consensus est que le Canada ne traverse pas actuellement une crise, mais que la situation est extrêmement fragile et que la trajectoire pourrait se détériorer en l’absence de mesures correctives. Les opinions convergent sur un point : la situation financière était déjà tendue, et les prochaines années apporteront des pressions supplémentaires qui réduiront la marge de manœuvre à moyen et long terme. Les craintes sont généralisées quant à un dérapage structurel qui érode la crédibilité et augmente les coûts d’emprunt.
Quatre pressions principales pèsent sur les finances publiques :
- Dette héritée. Le gouvernement hérite d’une dette plus importante accumulée au cours des dernières années, ainsi que du poids des programmes sociaux nouveaux ou élargis. Plusieurs répondants ont signalé des pratiques budgétaires imprudentes au cours des trois dernières années, soupçonnant notamment que certains programmes aient été intentionnellement sous-financés afin de présenter un bilan budgétaire plus favorable qu’elle ne l’est en réalité. Même avant l’établissement de nouvelles priorités, le gouvernement canadien est confronté à une augmentation structurelle des dépenses et à un alourdissement de la charge d’intérêt qui réduit la marge de manœuvre budgétaire.
- Contraintes cycliques et structurelles. À court terme, le ralentissement économique dans un contexte d’incertitude commerciale exercera une pression à la baisse sur les recettes et activera les stabilisateurs. Au-delà du cycle, les changements structurels du système de commerce mondial (fragmentation, tensions géopolitiques, démographie) menacent la croissance du Canada s’ils ne sont pas compensés par des investissements visant à accroître la productivité. Une croissance tendancielle plus faible associée à des taux d’intérêt plus élevés constitue une situation difficile : elle augmente le ratio intérêts/recettes et rend la consolidation à la fois plus nécessaire et plus difficile.
- Le programme de Carney. Le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir avec un programme d’investissement ambitieux, qui doit être financé et mis en œuvre. Si certains répondants considèrent que le programme du gouvernement est stratégiquement judicieux, tous s’accordent à dire qu’il n’est pas négligeable sur le plan budgétaire. Outre les déficits très importants prévus pour les deux prochaines années, il semble que le gouvernement Carney envisage de normaliser indéfiniment les déficits structurels supérieurs à 1 % du PIB afin de financer les dépenses liées à l’investissement. Cela marque un changement de cap par rapport au gouvernement Trudeau, qui s’était toujours engagé à présenter des budgets presque équilibrés à moyen terme.
- Nouveaux engagements en matière de défense envers l’OTAN. Répondre aux attentes des alliés et aux besoins réels en matière de sécurité implique une augmentation pluriannuelle des dépenses de défense (en capital et de fonctionnement). Ces coûts sont inévitables et entrent en concurrence directe avec d’autres priorités, à moins que des compensations ne soient trouvées. Les pressions en matière de défense doivent donc être explicitement intégrées dans la trajectoire budgétaire, et non considérées comme exceptionnelles indéfiniment.
Selon les répondants, ces pressions renforcent la nécessité d’un cadre budgétaire crédible et obligeront à faire des choix plus difficiles que par le passé. Autrement dit, si nous voulons mettre en œuvre rapidement des projets visant à accroître la productivité, nous devons soit réduire les dépenses consacrées aux moins prioritaires, soit augmenter les recettes.
Risque de dégradation. Le consensus est qu’il n’y a pas de danger imminent de dégradation de la note de crédit, mais qu’il existe un risque important à l’avenir si la trajectoire budgétaire actuelle n’est pas corrigée. Malgré la stabilité actuelle, plusieurs experts mettent en garde contre une dégradation à moyen terme. Les agences de notation surveillent de près le respect des points d’ancrage de la dette et des cadres crédibles à moyen terme. Tout « dérapage » pourrait affaiblir le discours et déclencher une réaction négative.
Par rapport à ses pairs, le Canada jouit toujours d’une crédibilité institutionnelle et d’un accès aux marchés. La question porte sur la trajectoire et la résilience aux chocs, et on a le sentiment que la solide réputation du Canada en matière de crédibilité budgétaire s’est érodée après que le gouvernement précédent a manqué à plusieurs reprises ses propres objectifs.
La demande des investisseurs. Malgré cette trajectoire inquiétante, les experts s’accordent largement à dire qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter dans l’immédiat quant à l’appétit des investisseurs pour la dette du gouvernement canadien. Le Canada est toujours considéré comme un emprunteur de premier ordre par rapport à ses pairs internationaux. Cependant, cela ne doit pas être considéré comme une raison de se reposer sur ses lauriers. Les experts soulignent que cette stabilité repose sur une réputation de discipline budgétaire acquise dans les années 1990 et 2000, une réputation qui s’érode et qui « peut être compromise rapidement et sans avertissement ».
2) La question de l’investissement
Il existe un consensus unanime sur la nécessité d’accroître les investissements dans l’économie afin de stimuler la productivité et la croissance du Canada, qui sont à la traîne. Cela est considéré comme essentiel à la viabilité financière à long terme. Les économistes et les chefs d’entreprise se montrent tolérants à l’égard des emprunts destinés à financer des investissements permettant une réelle augmentation de la productivité, à condition que la discipline soit maintenue dans le cadre d’un plan de consolidation à moyen terme.
La majorité des chefs d’entreprise acceptent des déficits structurels plus élevés s’ils servent à financer des « initiatives favorables à l’économie ». Un répondant l’a formulé ainsi : « Nous avons besoin d’investissements dans la productivité, la diversité des marchés, les projets d’intérêt national, la défense et la sécurité — un réveil important pour le pays qui dort depuis 15 ans et qui exige des mesures à court terme ».
Les experts sont du même avis. Un investisseur a déclaré : « Si vous faites des choses qui vont améliorer la croissance économique à l’avenir, c’est en fait une très bonne chose d’emprunter de l’argent pour le faire ».
Dans un même temps, il est reconnu que l’enveloppe budgétaire actuelle offre peu de marge de manœuvre pour des déficits soutenus, même pour l’investissement. De nombreux experts soulignent que des déficits structurels supérieurs à 1 % du PIB pourraient être incompatibles avec la stabilisation des ratios de la dette, compte tenu des hypothèses actuelles en matière de croissance et de taux d’intérêt.
Répartition entre dépenses de fonctionnement et dépenses en capital. La proposition visant à séparer officiellement le budget en dépenses de fonctionnement et dépenses en capital/investissement a été au cœur du débat. Les partisans de cette proposition ont fait valoir qu’il était logique d’équilibrer le budget de fonctionnement tout en empruntant pour financer des projets qui améliorent la croissance à long terme.
Les sceptiques, en particulier ceux qui avaient une expérience dans la fonction publique, se montraient méfiants. Ils ont mis en garde contre la tentation de reclasser les dépenses courantes en « investissements » afin d’échapper aux réalités budgétaires, soulignant que le terme « investissement » peut être interprété de manière très large. Un expert a qualifié cette mesure d’occasion de manipulation, soutenant que la comptabilité d’exercice appropriée amortit déjà les coûts d’investissement et que cela ne ferait que « dissimuler les déficits d’une manière plus acceptable ». Un autre a plaisanté : « Je suis un économiste qui pourrait probablement justifier n’importe quoi, sauf la construction d’un gazébo ».
Conclusion générale : si elle est mise en œuvre, la séparation doit reposer sur des définitions claires et publiques, et une grande transparence. Sinon, la crédibilité serait compromise.
Surveillance. Il existe un soutien en faveur du renforcement du rôle du Bureau du directeur parlementaire du budget (BDPB) en matière de surveillance et de la simulation de crise, mais pas en faveur de l’octroi de pouvoirs d’application. Beaucoup ont fait remarquer que le BDPB manque actuellement de personnel et d’équipement et qu’il aurait besoin de ressources beaucoup plus importantes pour remplir un tel mandat.
3) Points d’ancrage et garde-fous
Tous les groupes s’accordaient presque unanimement à dire que les points d’ancrage budgétaires sont importants.
Une grande majorité de dirigeants et d’experts considèrent que les points d’ancrage sont extrêmement importants, voire essentiels pour garantir la discipline politique, obtenir l’adhésion des fonctionnaires et imposer des compromis explicites. Les points d’ancrage budgétaires sont également surveillés de près par les agences de notation.
Approche de tableau de bord. Une majorité se prononce en faveur d’une « combinaison » ou d’un « tableau de bord » de mesures, affirmant qu’aucun indicateur unique ne peut refléter la situation dans son ensemble. Le ratio dette/PIB est l’indicateur le plus fréquemment cité, la plupart des personnes interrogées préconisant une trajectoire stable ou en baisse à moyen terme. Un groupe a souligné que les coûts du service de la dette (en pourcentage du PIB ou des recettes) constituaient un meilleur indicateur, car ils reflètent la pression exercée sur les dépenses de programmes. Les répondants les plus intransigeants ont plaidé en faveur de budgets équilibrés ou d’importants excédents primaires, invoquant la crédibilité du marché.
Certains répondants ont souligné que la dette brute est un indicateur plus pertinent du risque de marché que la dette nette, souvent citée. La dette peut être trompeuse, car elle prend en compte des actifs qui ne sont pas liquides en cas de crise.
Règles opérationnelles. Les répondants ont souligné que les points d’ancrage doivent être traduits en règles applicables. Exemples suggérés : maintenir la croissance des dépenses de fonctionnement en dessous du PIB nominal ; publier un plan de réduction absolue du déficit ; interdire les nouveaux programmes permanents sans financement permanent ; et appliquer un critère d’investissement aux dépenses en capital.
Des cadres bien conçus associeraient un point d’ancrage de viabilité à long terme (comme la baisse du ratio dette brute/PIB) à des règles opérationnelles (comme un plafond des dépenses ou une cible de solde primaire), tout en surveillant les indicateurs d’alerte précoce (comme le ratio du service de la dette).
Les répondants s’accordent à dire que les garde-fous doivent être flexibles, s’appliquer tout au long du cycle économique et inclure des clauses échappatoires structurées et crédibles en cas de chocs majeurs.
4) Discipline interne
Un thème récurrent est que la discipline au sein du gouvernement s’est affaiblie depuis la pandémie. Les recettes imprévues ont généralement été dépensées, les programmes « temporaires » ont persisté et les points d’ancrage ont changé. Une critique courante à l’égard du gouvernement Trudeau précédent était qu’il dépensait les recettes inattendues au lieu d’effectuer des investissements de manière productive.
Les experts estiment que la « mémoire musculaire » institutionnelle en matière de restriction budgétaire, forgée dans les années 1990, s’est atrophiée. Il en résulte un système où la tendance par défaut est de dépenser.
- Dépenser les recettes imprévues : Une critique majeure concerne la « disposition de l’esprit » qui s’est installé, selon lequel les recettes imprévues sont considérées comme une occasion pour de nouvelles dépenses plutôt qu’une occasion de réduire le déficit. Comme l’a décrit l’un des répondants, « chaque année, les chiffres sont un peu plus favorables que les années précédentes, et, comme par magie, on dispose d’une multitude de nouvelles dépenses à effectuer ». Un autre expert a fait remarquer que tous les budgets du gouvernement précédent « ne constituaient en fait qu’une base à partir de laquelle ils allaient dépenser davantage ».
- Les programmes « temporaires » deviennent permanents : Les experts ont mis en garde contre les « jeux » budgétaires qui sapent la crédibilité budgétaire, tels que le fait de classer les programmes populaires sur le plan politique comme temporaires afin que leurs coûts en long terme n’apparaissent pas dans la trajectoire budgétaire. Comme l’a expliqué l’un des répondants, « il existe de nombreux programmes à durée limitée qui bénéficient d’un renouvellement tous les cinq ans, et certains d’entre eux existent depuis les années 1970 », ce qui crée un déficit structurel important et délibérément sous-estimé.
Afin de rétablir la crédibilité, les parties prenantes ont formulé certaines recommandations visant à imposer un changement de comportement et de culture :
- Révision du programme fondée sur les « principes fondamentaux » : La recommandation la plus courante est une révision rigoureuse des programmes. Cela impliquerait de poser des questions fondamentales sur chaque programme : le gouvernement devrait-il même intervenir dans ce domaine ? Si oui, est-ce une fonction que le gouvernement fédéral devrait assumer, ou est-ce que les provinces pourraient mieux s’en charger ? Si c’est une fonction fédérale, est-ce qu’un tiers pourrait s’en acquitter plus efficacement que nous ?
- Mécanismes tactiques : Pour faire respecter la discipline au quotidien, les experts et les membres recommandent un renforcement de la surveillance exercée par le Conseil du Trésor, la reconstitution de réserves pour éventualités explicites dans le budget et la publication de « tableaux de bord trimestriels succincts » afin de suivre les progrès réalisés en matière de points d’ancrage et d’investissements.
5) Recettes et dépenses
La plupart des experts et des chefs d’entreprise affirment que le Canada n’a pas de problème de recettes, mais un problème de dépenses. Ils préconisent de maîtriser la croissance des dépenses de programmes. Pourtant, certains estiment que les nouvelles pressions sur les dépenses, en particulier dans le domaine de la défense, rendent inévitable la recherche de nouvelles recettes.
L’examen actuel des dépenses publiques mené par Carney a été accueilli avec un profond scepticisme, compte tenu de sa portée limitée.
Il n’y a pas de consensus sur les recettes supplémentaires. Les dirigeants sont sceptiques quant aux nouvelles taxes et préfèrent la retenue. Les experts sont plus ouverts à la possibilité que des recettes supplémentaires soient nécessaires.
Un groupe d’experts a vigoureusement soutenu que le Canada ne connaît pas de manque à gagner. Comme l’a déclaré l’un d’entre eux, « Les États-Unis ont un manque à gagner… Ce n’est pas le cas du Canada. Nos recettes actuelles se situent dans la moyenne ». Un autre expert a abondé dans ce sens, soulignant que, sur le long terme, les recettes sont « proches des normes à long terme » et qu’« on ne peut tout simplement pas affirmer que les recettes sont exceptionnellement faibles ».
Le camp adverse estime que les nouvelles pressions sur les dépenses, en particulier dans le domaine de la défense, rendent inévitable la recherche de nouvelles recettes. Un expert s’est montré catégorique : « Je ne vois pas comment l’augmentation des dépenses de défense à 5 % du PIB pourrait se faire sans une augmentation des recettes ». Un autre a fait valoir que, si la société souhaite maintenir le niveau actuel des dépenses de programmes, « de nouvelles sources de recettes sont indispensables ».
Bien que divisés sur le « si », les experts étaient remarquablement d’accord sur le « comment ». Si le gouvernement doit augmenter ses recettes, il existe un important consensus sur le fait qu’il devrait utiliser la taxe sur les biens et services (TPS), car c’est l’option la moins perturbatrice.
6) Réforme fiscale
Outre le large soutien en faveur d’une révision complète du programme, la réforme fiscale globale bénéficie d’un soutien quasi unanime. Le système actuel est décrit comme étant trop complexe, non concurrentiel et désuet. La simplification, l’élargissement de l’assiette fiscale et la réduction des taux d’imposition effectifs sur l’investissement étaient des thèmes récurrents.
L’appel à la réforme est universel, les experts affirmant qu’elle est « attendue depuis longtemps ».
Les priorités en matière de réforme varient, mais les thèmes communs sont les suivants :
- Simplification : Éliminer les nombreux « crédits d’impôt ultraciblés et autres artifices qui compliquent le code fiscal ».
- Compétitivité : Réduire les « taux marginaux d’imposition relativement élevés » au Canada afin de décourager « l’exode des cerveaux » et réduire le taux marginal d’imposition effectif sur les nouveaux investissements des entreprises.
- Révision des dépenses fiscales : Un expert a fait remarquer que les dépenses fiscales représentent davantage de revenu perdu que le gouvernement perçoit en impôts sur le revenu des particuliers et qu’elles devraient faire l’objet d’un examen systématique.
Plusieurs répondants ont souligné que les défis budgétaires ne peuvent être dissociés du problème plus large de la compétitivité du Canada. La discipline budgétaire n’est pas une fin en soi, mais un moyen de favoriser la croissance.
Outre les impôts, les experts et les membres considèrent les obstacles réglementaires comme « insurmontables » et comme l’une des principales raisons pour lesquelles le Canada est devenu un pays où il est « difficile d’investir ».
7) Coordination monétaire et budgétaire
Les consultations d’experts ont débouché sur un consensus fort selon lequel les politiques monétaire et budgétaire doivent rester distinctes et indépendantes, la politique monétaire étant axée sur son mandat en matière d’inflation et la stabilisation des cycles économiques, tandis que la politique budgétaire devrait être axée sur la croissance et la viabilité à long terme.
En fait, une politique budgétaire crédible est considérée comme essentielle pour garantir que la banque centrale puisse réellement remplir sa mission. En effet, l’une des principales préoccupations est le risque de « domination budgétaire », qui se produit lorsque les décisions de la banque centrale sont limitées par les besoins de financement du gouvernement.
- La politique monétaire en tant que premier intervenant : Il existe une opinion très répandue selon laquelle, en cas de ralentissement cyclique normal, la politique monétaire devrait être le principal outil utilisé. Comme l’a fait valoir un expert, tant que les taux d’intérêt « ne sont pas encore à zéro, ni même proches de zéro », nous devrions « laisser la politique monétaire faire son travail en premier lieu », cela ne coûte rien au budget du gouvernement et contribue en fait à réduire les coûts du service de la dette. Les mesures de relance budgétaire à grande échelle, telles que les versements directs aux ménages, sont des outils qui devraient être réservés aux crises graves, lorsque la banque centrale a déjà réduit ses taux d’intérêt à zéro et qu’elle est à court de munitions.
- Politique budgétaire pour les problèmes structurels : Le rôle de la politique budgétaire n’est pas de gérer la demande à court terme, mais de relever les défis profonds et à long terme auxquels le pays est confronté. Comme l’a expliqué l’un des répondants, les outils budgétaires keynésiens traditionnels sont conçus pour faire face aux « fluctuations de la demande globale ». Ce n’est pas le problème. Nous avons un gros problème structurel, et la politique doit être orientée vers sa résolution.
- Le risque principal : La domination budgétaire se produit lorsque l’objectif principal de la banque centrale passe du contrôle de l’inflation à l’aide au financement du déficit du gouvernement, par exemple en maintenant les taux d’intérêt artificiellement bas. Un expert, citant la trajectoire des États-Unis, a déclaré que le Canada doit « éviter à tout prix la domination budgétaire ». Il a été souligné que si le gouvernement mène une politique budgétaire irresponsable, cela peut affaiblir et, à terme, dominer la banque centrale. Comme l’a dit l’un des répondants : « En fin de compte, c’est le côté budgétaire qui détermine la situation, et la banque centrale ne peut pas faire grand-chose » si la politique budgétaire prend une direction divergente et non viable. C’est pourquoi un plan budgétaire crédible est considéré comme essentiel pour permettre à la Banque du Canada de faire son travail efficacement.
8) Taille du gouvernement
Un thème important et distinct concernant la taille et le champ d’activité du gouvernement est ressorti des consultations, en particulier de la part des experts ayant une expérience antérieure dans la fonction publique et des chefs d’entreprise. Le consensus est que le déficit budgétaire est souvent un symptôme d’un problème plus fondamental : un gouvernement fédéral qui est devenu trop important, inefficace et qui a étendu son champ d’activité au-delà de ses fonctions de base essentielles.
Une école de pensée distincte a émergé, moins axée sur les mesures traditionnelles de viabilité budgétaire et dont l’intérêt se porte sur la taille absolue du gouvernement lui-même. Un expert a clairement exprimé ce point de vue : « De manière générale, je suis moins intéressé par les mesures de viabilité des finances publiques que par celles qui concernent la taille et le champ d’activité du gouvernement lui-même, en particulier l’augmentation des dépenses ou la part du gouvernement dans le PIB ».
Pour ce groupe, l’objectif principal n’est pas la réduction du déficit en soi, mais plutôt la réduction de la taille du gouvernement afin de mieux correspondre aux recettes. La préférence va à un « gouvernement plus petit et plus limité », la réduction du déficit étant une conséquence positive de la réalisation de cet objectif principal.
9) Conseils généraux
Les consultations comprenaient des commentaires ouverts des parties prenantes sur les impératifs stratégiques pour le gouvernement. Les conseils donnés portaient principalement sur la nécessité de poursuivre sans relâche la croissance économique et de faire preuve du courage politique nécessaire pour apporter les changements requis.
La croissance économique comme objectif central : Le conseil principal est de réorienter la politique budgétaire, en passant de la redistribution à la promotion d’une croissance tirée par le secteur privé. Cela comprend une réforme réglementaire ambitieuse visant à faire du Canada un pays attrayant pour l’investissement, la mise en place d’infrastructures favorisant le commerce et la garantie d’une compétitivité fiscale par rapport aux États-Unis.
S’attaquer de front à l’inefficacité du gouvernement : Nous avons entendu des témoignages éloquents sur la façon dont des processus désuets et une culture du risque zéro ont engendré d’énormes inefficacités dans les opérations gouvernementales. Il existe une forte conviction que la modernisation de la fonction publique et l’application de principes axés sur les risques pourraient permettre de réaliser d’énormes économies.
Un appel au courage politique et à une vision de long terme : Un thème récurrent est la nécessité pour le gouvernement de dépasser les calculs politiques à court terme. Les membres et les experts réclament le courage nécessaire pour faire des compromis difficiles, avoir une conversation honnête avec les Canadiens au sujet des défis à venir et mettre en œuvre un plan crédible à long terme qui va au-delà du prochain cycle électoral.