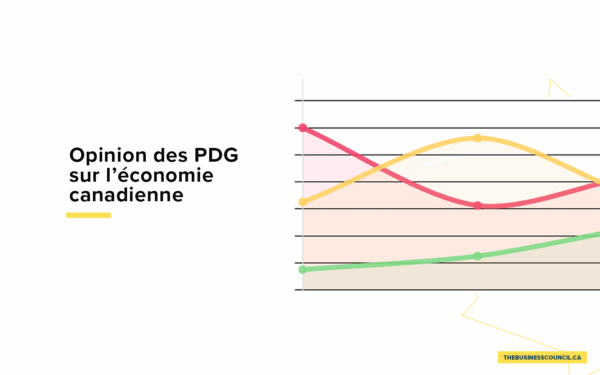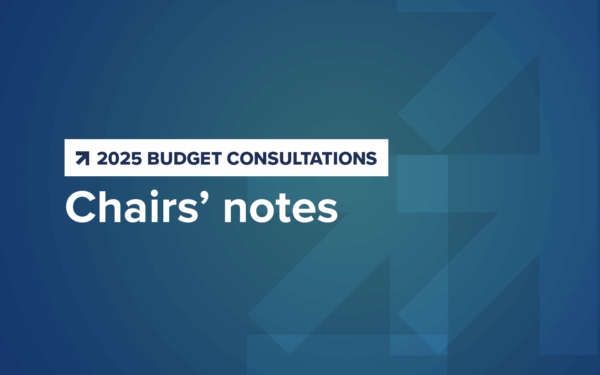Étouffé par la bureaucratie
CONTEXTE
La tendance à la déréglementation se poursuit. Des promesses d’Elon Musk d’allumer un « feu de joie des réglementations absurdes » au nom de la liberté, à l’engagement moins grandiloquent, mais plus fructueux de l’Argentine de « passer la tronçonneuse » dans les règlements du gouvernement, les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise du monde entier se sont lancés dans une campagne visant à faire reculer les organismes de réglementation gouvernementaux.
Au Canada, le débat sur la réglementation excessive est loin d’être une mode passagère. La frustration liée à la concurrence entre les différentes administrations, à la formulation vague des textes et à la paperasserie administrative sans fin s’est accumulée au point de remettre en question la réputation du Canada en tant qu’endroit stable et fiable pour l’investissement.
Mais l’appel à un système plus souple au Canada n’est pas un appel à une déréglementation totale à la Musk ou à la Javier Milei. De manière générale, il est reconnu que des règles raisonnables appliquées de manière prévisible servent à protéger l’intérêt public et permettent aux entreprises d’obtenir l’acceptabilité sociale nécessaire pour exercer leurs activités qui stimulent l’économie, l’emploi et les salaires décents dans le pays.
Les organismes de réglementation et les législateurs doivent toujours trouver le juste équilibre entre la protection de l’intérêt public et la possibilité pour les entreprises légitimes de prospérer. Il existe un équilibre délicat entre la protection et la restriction du bien-être des citoyens. La réglementation a un coût, et au Canada, ce coût est notre croissance économique et notre avenir.
Aujourd’hui plus que jamais, alors que notre économie doit absolument gagner en autonomie et en efficacité, cette ligne de démarcation est d’une importance capitale. Les entreprises et les investisseurs dans un large éventail de secteurs se disent découragés par le fardeau réglementaire. En tant que pays, nous sommes du mauvais côté de cette ligne alors que nous ne pouvons pas nous le permettre. L’Organisation de coopération et de développement économiques classe régulièrement le fardeau réglementaire du Canada parmi les plus lourds de ses membres. S&P Global souligne qu’il faut en moyenne environ 20 ans au Canada pour approuver un projet minier, soit beaucoup plus longtemps qu’ailleurs. The Economist a désigné le Canada comme un « paradis pour les comptables » en raison de son code fiscal de plus en plus complexe.
« L’impact économique est indéniable », affirme Stéphane Marion, économiste en chef à la Banque Nationale, qui a analysé les chiffres.
Le Conseil canadien des affaires mène régulièrement des sondages auprès de ses membres — les dirigeants des plus grandes entreprises canadiennes, issues de tous les secteurs de l’économie et de toutes les régions du pays. À chaque fois, ils placent le fardeau réglementaire en tête de liste des facteurs qui influencent leurs décisions d’investissement futures.
En effet, les préoccupations relatives à la réglementation surpassent même celles concernant le commerce avec les États-Unis. Contrairement aux droits de douane étrangers, le Canada a le contrôle sur ses lois et règlements.
De plus, lorsqu’on demande aux PDG ce qui devrait changer pour améliorer le climat des affaires au Canada, la réduction du fardeau réglementaire est de loin la réponse la plus fréquente.
Qu’il s’agisse de règles fiscales lourdes, de paperasserie excessive, de chevauchements entre les compétences fédérales et provinciales, de formulations vagues ou de formulaires désuets conçus pour faire face à des risques passés, l’accumulation de petites choses ralentit considérablement les entreprises.
En matière de délais, les retards rencontrés par de nombreux secteurs pour obtenir les autorisations réglementaires sont bien connus, en particulier dans les secteurs clés pour la croissance future, tels que les ressources naturelles, les infrastructures et les transports. Ils découragent les investissements et nuisent à la réputation du Canada à l’échelle internationale.
Ces problèmes exigent des solutions qui vont bien au-delà d’un appel collectif à réduire les formalités administratives ou à écarter le gouvernement du chemin des entreprises.
Cependant, les solutions ne sont pas évidentes lorsque le problème se compose de dizaines de milliers d’exigences qui interagissent entre elles de multiples façons, et de manière différente pour chaque secteur de l’économie.
Les tentatives répétées du gouvernement et des entreprises pour alléger le fardeau réglementaire au Canada échouent souvent, car il n’existe pas de guichet unique ni de solution simple. Une déclaration visant à éliminer la paperasserie n’a aucun sens si elle n’est pas accompagnée d’une analyse approfondie et continue du problème et d’une volonté équivalente de concevoir des approches plus efficaces.
Une seule réglementation mal conçue est agaçante. Des milliers de règlements qui ratent leur cible constituent un événement macroéconomique.
Dans ce bref rapport, nous décrirons le problème tel que nous le percevons, nous présenterons un processus de réparation et nous proposerons une liste des 10 obstacles les plus pénibles. Il faut bien commencer quelque part.
LE PROBLÈME
Les entreprises canadiennes qualifient l’enchevêtrement de formalités administratives auquel elles sont confrontées de « pancaking ». Les règlements s’empilent les unes sur les autres, formant un ensemble complexe de procédures qui nécessite une armada d’avocats et des millions de dollars pour être démêlé.
Le fardeau réglementaire qui pèse sur l’exploitation des ressources naturelles au Canada est bien documenté, mais la réalité est que ce défi touche tous les secteurs et toutes les industries de notre économie. Après des années de discussions animées, les dirigeants provinciaux et fédéraux ont maintenant reconnu publiquement que l’incohérence et les chevauchements ralentissent tout le monde, et ils se sont engagés à rationaliser les processus et à réduire le fardeau des obstacles interprovinciaux. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.
Le nombre même de règlements, qu’ils soient rationnels ou non, constitue en soi un obstacle majeur au bon fonctionnement et à la croissance de l’économie.
Si vous demandez à l’intelligence artificielle de Google de déterminer le nombre de règlements au Canada, elle ne vous donnera pas de réponse précise, se contentant de la description « vaste éventail ».
Et il est difficile de trouver une liste exhaustive au sein de la bureaucratie fédérale.
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui publie des rapports réguliers sur les formalités administratives, estime ce nombre à au moins 170 000.
Un article récent de Statistique Canada est probablement le plus complet. Il estime le nombre total d’exigences réglementaires au Canada à 321 000 en 2021.
Bien sûr, certaines de ces exigences protègent les Canadiens, peuvent contribuer à améliorer l’économie et, dans certains cas, créent des emplois, notamment dans les services de conformité des entreprises, qui ont besoin de personnel supplémentaire pour traiter un nombre croissant de documents réglementaires.
Mais, comme le souligne clairement ce document, c’est l’accumulation sans relâche des règlements qui est préoccupante. Le nombre d’exigences réglementaires en 2021 était supérieur de 37 % à celui de 2006. Dans le secteur manufacturier, les exigences réglementaires ont augmenté de 41 % au cours de cette période.
Statistiques Canada, graphique 1
En conséquence, l’analyse de Statistique Canada attribue à la charge réglementaire la responsabilité de la contraction de 1,7 % de la taille de l’économie, de la baisse de 1,3 % de l’emploi et de la chute de 9 % de l’investissement des entreprises par rapport à ce qu’ils auraient été autrement.
Le « pancaking » est endémique et se développe à un moment où le Canada peut le moins se le permettre.
Notre productivité est en baisse, les investissements des entreprises sont médiocres et la relation commerciale la plus importante du Canada, celle avec les États-Unis, est en crise. Le moyen le plus efficace de contrer l’instabilité du commerce est de veiller à ce que notre économie soit aussi efficace et compétitive que possible.
La réduction des règlements lourds et coûteux constitue le meilleur point de départ. Cette approche est peu coûteuse et, si elle est mise en œuvre avec précision, elle peut avoir des retombées immédiates pour les entreprises et l’économie en général.
MAIS COMMENT Y PARVENIR ?
Dans une récente perspective économique, les analystes de politique du cabinet d’avocats Bennett Jones ont clairement souligné l’urgence de réduire le fardeau réglementaire alors que le gouvernement fédéral poursuit son ambition de faire progresser l’économie canadienne :
« C’est en grande partie le marché, et non les gouvernements, qui entreprendra le développement de corridors commerciaux, qui élargira et diversifiera les marchés ou qui développera les meilleures applications d’IA », écrivent-ils. « La première tâche des gouvernements est d’établir un environnement prévisible et compétitif pour les investissements et de supprimer les obstacles réglementaires qui ne servent aucun intérêt évident et convaincant en matière de politique. »
Les chefs d’entreprise, les investisseurs et les experts en politique s’accordent largement à dire que le Canada compte trop de règlements, dont certains sont mal conçus, et que les perspectives d’investissement s’amélioreraient si les plus contraignants étaient supprimés ou modifiés.
Mais comment y parvenir ? Chaque secteur et chaque région ont une longue liste de sources d’irritation qui ne concernent que leur segment particulier de l’économie.
Certaines analyses regroupent les plaintes par thèmes, ce qui est utile pour comprendre les raisons générales d’une réglementation lourde, mais moins utile pour hiérarchiser les règlements à supprimer ou à modifier.
La liste comprend :
- des taxes complexes,
- des exigences vagues ou ambiguës,
- de longs délais dans le traitement des documents administratifs,
- des chevauchements et des dédoublements entre les gouvernements et entre les ministères,
- des contradictions entre les administrations,
- des permis pour des ajustements mineurs,
- des organismes de réglementation peu enclins à prendre des risques et des règlements qui pouvaient avoir un sens à une autre époque, mais qui ne sont plus pertinents aujourd’hui,
- et bien d’autres encore.
La technologie peut nous aider à identifier plus précisément les grains de sable dans les rouages de la réglementation.
En 2018, l’Université d’Ottawa a utilisé l’intelligence artificielle pour analyser le texte de 3 196 règlements afin de détecter les archaïsmes, les chevauchements et les règlements complexes. L’analyse a été menée par le professeur Wolfgang Alschner de la Faculté de droit et préparée pour l’École de la fonction publique du Canada.
Les règlements contenant les mots « fac-similé » ou « microfiche », par exemple, ont été signalés comme obsolètes. Les règlements contenant des milliers de mots et de clauses ont été signalés comme étant trop complexes (la Loi sur l’aéronautique remporte la palme). Ils ont également recherché les « chevauchements textuels » entre les textes réglementaires et ont constaté que 1 116 règlements présentaient 70 % de similitudes avec d’autres règlements. Ils ont également classé les règlements en fonction de leur complexité, de leur flexibilité et de leur rigidité.
Le résultat a été un classement des règlements par variable, qui pourrait être utile pour réduire les formalités administratives si le travail était effectué en temps réel sur tous les règlements dans toutes les administrations.
Au Parlement, le sénateur de Nouvelle-Écosse Colin Deacon propose une approche différente. Il a fortement préconisé une approche normative de l’élaboration des règlements, qui privilégie les résultats plutôt que l’intervention réglementaire axée sur les processus dans les détails des pratiques commerciales.
Ironiquement, des règlements gouvernementaux sur la réglementation gouvernementale pourraient être utiles.
À l’échelle fédérale, le Secrétariat du Conseil du Trésor compte une équipe et un sous-ministre adjoint chargés de mettre en œuvre la Loi sur la réduction de la paperasserie, adoptée en avril 2015, qui oblige le gouvernement à supprimer un règlement pour chaque nouveau règlement adopté.
L’Énoncé économique de l’automne 2024 (EEA) a proposé la création d’un bureau de réduction du fardeau administratif, financé à hauteur de 28 millions de dollars provenant des fonds existants du Conseil du Trésor. L’EEA a déclaré que ce nouveau bureau accélérerait la réduction des formalités administratives, assurerait le suivi de ses travaux et consulterait davantage les entreprises, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des transports, de la production d’électricité, de l’innovation, de la médecine et de la santé.
Mais le nouveau bureau est encore en cours de développement.
Plus récemment, Laurent Ferreira, chef de la direction de la Banque Nationale du Canada et membre du conseil d’administration du Conseil canadien des affaires, a appelé à la nomination d’un responsable non partisan chargé de la déréglementation afin d’identifier et de recommander la suppression des formalités administratives contre-productives, condition préalable à la consolidation de la compétitivité du Canada.
Et cet été, le président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, a donné aux organismes de réglementation fédéraux et aux ministres 60 jours pour présenter une liste des règlements qui peuvent être supprimés.
Pour sa part, le Conseil canadien des affaires a demandé à ses membres, dont les entreprises sont directement touchées par les formalités administratives, de présenter une liste des règlements les plus contraignants.
Comme on pouvait s’y attendre, chaque secteur a présenté une liste très différente. Et les répercussions économiques de chaque recommandation dépassent le cadre du présent document. Mais nous devons aller au-delà des thèmes généraux et des plaintes de longue date et nous concentrer davantage sur les règlements manifestement abusifs qui font obstacle à un commerce efficace et responsable.
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :
Nous avons discuté avec divers membres du CCA issus d’un large éventail de secteurs, consulté des associations industrielles et dressé une liste des 10 domaines les plus contraignants.
1) Délivrance de permis pour les projets d’infrastructure
Ce domaine est emblématique des formalités administratives au Canada. Le gouvernement fédéral exige que certains projets soient approuvés de l’Agence d’évaluation d’impact, et les provinces ont également leurs propres organismes de réglementation.
Le Canada éprouve depuis des décennies des difficultés à approuver efficacement les grands projets essentiels à la réussite économique du pays. Les gouvernements successifs ont proposé des politiques bien intentionnées visant à accélérer les autorisations tout en maintenant un niveau élevé d’intégrité environnementale et en tenant compte des intérêts des communautés locales et autochtones. Cependant, la délivrance de permis reste excessivement complexe et longue, ce qui constitue un obstacle majeur à l’attraction des investissements au Canada. Un rapport récent de S&P Global a révélé que le processus canadien pour les projets miniers, de la découverte à la production, est l’un des plus longs au monde, avec une durée d’environ 20 ans.
Depuis son entrée en vigueur en 2019, la Loi sur l’évaluation d’impact continue de susciter la controverse et a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada en 2023. Bien que des modifications aient été proposées, il est possible et nécessaire d’en faire davantage pour approuver des projets qui profitent aux intérêts économiques et nationaux du Canada. En particulier, le Règlement sur les activités concrètes pris en vertu de la Loi doit être examiné attentivement afin de s’assurer que les projets énumérés dans le règlement relèvent bien de la compétence fédérale plutôt que provinciale. Cela permettra d’éviter que les promoteurs ne soient soumis à des processus d’approbation coûteux, longs et redondants. Des modifications peuvent également être apportées afin d’accélérer les autorisations pour les projets situés dans les endroits où une décision favorable et des permis environnementaux ont déjà été obtenus, comme dans le cas d’une emprise existante ou d’une friche industrielle.
Beaucoup reste également à faire pour délivrer les permis environnementaux après l’approbation d’un projet. Les nouveaux délais fixés dans la Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre, et la création d’un coordonnateur des permis fédéraux au sein du Bureau du Conseil privé constituent des avancées importantes pour répondre aux préoccupations de longue date du secteur privé.
2) Complexité des services financiers :
Les banques et les sociétés d’assurance relèvent de plusieurs organismes de réglementation différents : le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministère des Finances, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, la Société d’assurance-dépôts du Canada, le CANAFE et, dans certains cas, les organismes de surveillance provinciaux et les organismes de réglementation de la sécurité. La Banque du Canada surveille de près la stabilité financière.
La Loi sur les banques et d’autres lois sont examinées régulièrement, et la réglementation évolue constamment afin de refléter les normes mondiales en matière d’exigences de fonds propres, de divulgation sur le climat, d’évolution technologique, de cybersécurité et de gestion des risques.
Ironiquement, ces changements constants sont à la fois trop lents pour permettre aux entreprises de suivre la concurrence et les tendances mondiales, et trop lourds et complexes pour que les responsables de la conformité puissent les suivre. Si les entreprises du secteur reconnaissent la valeur pour les organismes de réglementation de maintenir des normes élevées, le respect de règles rigides et le chevauchement des agences ralentissent le rythme des activités et peuvent freiner la modernisation.
3) Étiquettes des emballages :
Les exigences en matière d’étiquetage des biens emballés sont multiples et croissantes, et chaque modification entraîne une cascade de coûts de mise en conformité. La mise en place d’équipes chargées de tester et de mettre en œuvre les nouvelles exigences est particulièrement coûteuse pour les entreprises du secteur alimentaire et cosmétique.
De plus, l’emballage est devenu un enjeu politique, et les changements de caractère partisan risquent d’être abrogés ou modifiés à nouveau au gré des vents politiques.
Alors que les libéraux ont présenté plusieurs propositions relatives à l’étiquetage des emballages, le programme électoral du Parti conservateur de 2025 promettait de supprimer les exigences en matière d’étiquetage des produits de santé naturels. Pour les entreprises, s’adapter à ces changements est extrêmement coûteux, se chiffrant en millions de dollars.
Un exemple récent est la réglementation relative à l’étiquetage sur le devant des emballages, qui exige des entreprises d’ajouter un symbole nutritionnel sur le devant de l’emballage dans l’espace d’affichage principal pour indiquer que l’aliment est riche en un ou plusieurs des éléments suivants : gras, sodium et/ou sucre. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Après des réactions négatives et une controverse, Santé Canada a autorisé des exemptions pour certains produits, notamment le bœuf haché, l’alcool et d’autres aliments.
À l’heure actuelle, la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues, ainsi que les lois et règlements provinciaux, tels que la Charte de la langue française du Québec, imposent des règles en matière d’étiquetage. La Loi sur la concurrence et la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation sont toutes deux utilisées pour faire respecter et réglementer les allégations trompeuses sur les étiquettes.
Un autre exemple est le Registre fédéral sur les plastiques introduit en avril 2024 et qui entrera en vigueur en septembre 2025. La phase 1 du registre prévoit la publication de rapports annuels sur la quantité et les types de plastiques utilisés dans la fabrication, l’importation et/ou la mise sur le marché, ainsi que sur la quantité de plastiques générés et leur utilisation. Cela s’ajoute aux rapports provinciaux requis pour les matériaux d’emballage. La phase 2 comprendra des rapports provenant de la plupart des secteurs de l’économie, et pas seulement des détaillants.
À l’échelle internationale, il s’agit de l’une des réglementations les plus contraignantes en matière de plastique, avec des amendes pouvant atteindre 1 million de dollars canadiens et des coûts de mise en conformité considérables. De plus, l’absence de consultation, d’orientation et de clarté en temps opportun crée une incertitude pour les entreprises. Dans l’ensemble, le registre fait double emploi avec les systèmes de déclaration existants, sans démontrer comment il contribuera à améliorer les résultats environnementaux.
4) Impôt minimum mondial :
Les impôts minimaux mondiaux (IMM) visent à garantir que les entreprises mondiales paient un niveau minimum d’imposition, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités, afin de dissuader les entreprises de se délocaliser vers des pays à faible imposition pour échapper au paiement de l’impôt. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a mené des efforts pour harmoniser les impôts minimums mondiaux, avec des résultats mitigés.
La proposition la plus récente comprenait deux piliers. Le premier pilier réaffecte les bénéfices des plus grandes multinationales, du pays où elles réalisent leurs revenus vers celui où elles vendent leurs produits et services. Le deuxième pilier impose une taxe de 15 % sur les bénéfices mondiaux des entreprises dans chaque pays où elles exercent leurs activités. Il n’y a pas eu de consensus sur le premier pilier en raison de désaccords sur les recettes fiscales, les détails techniques et les préoccupations relatives au traitement des entreprises américaines. L’absence de consensus sur le premier pilier a incité certains pays, dont le Canada, l’Union européenne et l’Inde, à mettre en place des taxes sur les services numériques (TSN).
En 2024, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM) afin de mettre en œuvre le deuxième pilier du cadre de l’OCDE. Plutôt que de modifier l’impôt sur le revenu des sociétés (IRS) au Canada, la LIMM est un système supplémentaire d’imposition des revenus des sociétés. L’une des difficultés réside dans les différences de terminologie ; certains termes utilisés dans la LIMM ne sont pas équivalents à ceux de l’IRC, ce qui pose des problèmes d’interprétation. L’ambiguïté peut entraîner des litiges, des retards et des amendes potentielles, en plus des coûts supplémentaires liés à la mise en conformité.
Plus récemment, le Canada se trouve désavantagé par la mise en œuvre de la LIMM, alors que le G7 a convenu d’exempter les entreprises américaines de l’impôt minimum mondial. Cette divergence confère en effet un avantage considérable aux entreprises américaines au détriment des multinationales canadiennes et internationales, alors que notre économie souffre d’un sous-investissement. Le CCA a toujours soutenu que la coopération avec les États-Unis dans tous les domaines liés à la fiscalité internationale est essentielle à la compétitivité et à l’investissement au Canada.
5) Résumés de l’étude d’impact de la réglementation :
Si les entreprises sous réglementation fédérale souhaitent demander une modification d’un règlement existant, le Conseil du Trésor leur demande souvent de contribuer à une proposition officielle qui doit ensuite être soumise au Cabinet. Le processus prend souvent 18 mois, même pour les modifications les plus banales.
Ces résumés de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) sont requis pour les nouveaux règlements et règles, ainsi que pour les modifications apportées aux règlements existants. Ils sont généralement publiés dans la Gazette du Canada, Partie 1, afin de présenter la justification, la consultation publique et les coûts et avantages attendus. Ces résumés visent à assurer la transparence et à appuyer la prise de décisions fondées sur des preuves.
Mais les entreprises trouvent souvent que ce processus n’est qu’une formalité administrative qui ne fait que confirmer, au bout de plusieurs mois, une orientation politique déjà bien établie.
Par exemple, lorsque Santé Canada a récemment décidé d’exiger l’étiquetage sur le devant des emballages, les groupes industriels ont constaté que leur contribution était ignorée et n’avait qu’une influence très limitée sur le débat politique. De même, les consultations du gouvernement sur la manière d’améliorer la participation significative à la réglementation ont révélé une profonde frustration parmi les parties prenantes quant au caractère superficiel du processus.
Pour les entreprises sous réglementation fédérale, en particulier celles du secteur des services financiers ou des télécommunications, les délais des REIR peuvent chevaucher avec d’autres processus réglementaires, ce qui rend le processus complexe.
6) Permis de travailleurs étrangers :
Les entreprises canadiennes ont souvent recours au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans leurs activités. Cependant, la réglementation relative à ce programme n’a pas suivi l’évolution de la situation. Plus précisément, les délais de traitement augmentent, certains migrants déjà présents au Canada perdant leur statut en raison des retards accumulés. Service Canada accuse d’importants retards qui ont prolongé les délais de traitement des études d’impact sur le marché du travail (EIMT) requises pour le renouvellement de la plupart des permis de travailleurs étrangers. Les délais de traitement des EIMT ont grimpé en flèche : le délai de traitement moyen est de 60 jours ouvrables en 2025 par rapport à 31 à 34 jours ouvrables en 2021.
Ensuite, une fois l’EIMT traitée, les entreprises demandent des permis de travail, une autre démarche qui peut prendre des semaines, voire des mois, selon le pays d’origine. Au moment où le travailleur peut commencer son emploi, les conditions commerciales peuvent avoir changé. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) accuse déjà des retards importants dans le traitement des demandes de permis de travail. Parallèlement, le gouvernement a annoncé la suppression de 3 300 emplois à IRCC, ce qui fait craindre de nouveaux retards. Reuters a rapporté qu’en raison de ces retards, de nombreux migrants n’ont plus accès aux services et certains travaillent illégalement. Récemment, un groupe d’entreprises québécoises a intenté une action en justice contre le gouvernement fédéral pour un montant de 300 millions de dollars canadiens en raison des changements importants apportés au Programme des travailleurs étrangers temporaires l’automne dernier. Ces entreprises affirment que le revirement de la politique d’Ottawa a entraîné une augmentation des coûts, mettant certaines d’entre elles en danger d’insolvabilité.
Les coûts bureaucratiques pour les entreprises participant au programme sont tout aussi importants. Pour beaucoup d’entre elles, la participation au programme exige un niveau d’expertise en matière de politique d’immigration que certaines entreprises et certains secteurs ne possèdent tout simplement pas.
7) Mosaïque de confidentialité :
En 2019, le gouvernement du Canada a créé une Charte numérique pour protéger les renseignements numériques. Cependant, la Charte n’était pas juridiquement contraignante et n’était pas inscrite dans la législation. Depuis lors, des tentatives ont été faites pour moderniser les lois sur la protection de la vie privée aux échelles fédérale et provinciale, sans coordination cohérente de la politique.
À l’échelle fédérale, le gouvernement Trudeau a proposé deux projets de loi (le projet de loi C-26 sur la cybercriminalité et le projet de loi C-27 sur le comportement numérique dans le secteur privé). Bien qu’aucun de ces projets de loi n’ait été adopté, ils peuvent éclairer les attentes futures en matière de législation sur la protection de la vie privée. S’ils étaient adoptés, ces deux projets de loi ajouteraient de la complexité, des chevauchements et une charge de travail supplémentaire pour les entreprises et pourraient, à l’inverse, limiter les possibilités pour les entreprises canadiennes dans l’économie fondée sur les données.
Entre-temps, les provinces ont adopté leurs propres lois sur la protection de la vie privée. Dans certains cas, ces mesures s’appliquent au secteur privé plutôt que les lois fédérales, y compris en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. D’autres provinces ont des lois sur la protection de la vie privée en matière de santé similaires à celles du gouvernement fédéral, notamment l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont également des lois sur la protection de la vie privée spécifiques à l’emploi.
L’existence de règlements fédéraux et provinciaux en matière de protection de la vie privée augmente les coûts d’exploitation et d’expansion des activités au Canada. Les entreprises doivent choisir entre maintenir différentes politiques de confidentialité pour chaque province ou adopter une politique unique qui répond aux normes les plus strictes. Cette mosaïque de politiques incite les entreprises à quitter les petites administrations où la réglementation est plus stricte.
On ne sait pas non plus ce qu’il adviendrait des règlements qui diffèrent entre le gouvernement fédéral et les provinces ; les entreprises devraient-elles se conformer aux deux ? C’est particulièrement le cas dans le domaine de l’intelligence artificielle, où la Colombie-Britannique et l’Alberta n’ont pas de dispositions spécifiques à l’IA, contrairement au Québec. Il existe également des lois sectorielles qui compliquent le chevauchement des lois et des règlements, notamment la Loi sur les banques, les lois relatives aux coopératives de crédit et les lois sur les rapports de solvabilité des consommateurs.
La solution consiste bien sûr à créer un cadre global pour la protection de la vie privée. Parmi les enseignements tirés des précédentes propositions de loi fédérale sur la protection de la vie privée, citons la clarification des exigences en matière de déclaration, l’interopérabilité avec les normes internationales et la flexibilité accordée aux entreprises pour s’adapter aux normes de protection de la vie privée.
8) Jours de congé payés :
Nous voulons tous aider les gens à rester chez eux lorsqu’ils sont malades, mais les congés payés pour raisons médicales ont été imposés à la hâte par le gouvernement fédéral pendant la pandémie et ne sont pas toujours adaptés à tous les secteurs.
Les règles issues de la législation adoptée en décembre 2022 stipulent que tout travailleur employé de manière continue dans un lieu de travail réglementé par le gouvernement fédéral doit avoir droit à 10 jours de congé annuel payés pour faire face à une maladie, une blessure, un don d’organe, des rendez-vous médicaux ou une quarantaine. Les employeurs sont responsables des coûts.
Les employeurs peuvent demander un certificat médical après cinq jours d’absence, la demande devant être faite au plus tard 15 jours après le retour de l’employé au travail.
Certains employeurs trouvent ces règles trop rigides. Certaines entreprises affirment que les règles ne tiennent pas compte des systèmes de RH qui combinent congés maladie, congés personnels et vacances, ni des nuances de la demande de main-d’œuvre.
Pour rendre les choses encore plus complexes, les règles fédérales ne correspondent souvent pas aux exigences provinciales. La Colombie-Britannique impose par exemple cinq jours, tandis que l’Ontario en exige trois.
9) Permis de construction :
Il faut en moyenne près de 250 jours pour obtenir un permis de construction au Canada, soit trois fois plus longtemps qu’aux États-Unis, malgré un consensus sur la nécessité d’accélérer la construction dans tout le pays.
Une étude publiée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a évalué le processus d’obtention d’un permis pour la rénovation d’une salle de bains dans 12 municipalités différentes. En moyenne, sept documents sont nécessaires pour un projet de rénovation de salle de bain d’une valeur de 20 000 dollars. Les longs délais d’obtention des permis (souvent mesurés en années plutôt qu’en semaines ou en mois) font augmenter les coûts du logement à un moment où l’accessibilité au logement est une préoccupation nationale.
À Toronto, le manque de personnel et les processus désuets ont contribué à un arriéré dans la délivrance des permis de construction, qui est passé de 21 mois en 2020 à un délai d’approbation moyen pondéré de 32 mois en 2022.
Les coûts liés à l’obtention des permis constituent un obstacle majeur à la construction de nouveaux logements. Le coût total des permis nécessaires pour une simple rénovation (tels que les permis de construction, de plomberie et d’électricité) varie entre 180 dollars canadiens à Charlottetown et 2 029 dollars canadiens à Vancouver. Dans la région de Toronto, les acheteurs doivent désormais débourser 350 000 dollars canadiens de plus que le coût de construction, soit environ un tiers du coût total.
Et puis, il y a les codes du bâtiment. Alors que les codes du bâtiment ont été créés dans le but de fixer des normes minimales, 374 modifications sont proposées pour les codes modèles nationaux de construction pour 2025, et 186 des 1 200 normes de référence sont en cours de mise à jour cette année. Même lorsque les entreprises se conforment aux codes de conformité de base, ils exigent souvent les technologies les plus récentes, et les plus coûteuses.
Il existe des appels à une réforme du Code national du bâtiment afin de permettre la construction de davantage de logements. La normalisation des codes du bâtiment entre les territoires de compétence réduirait la complexité et les risques pour les promoteurs, et pourrait permettre aux constructeurs de logements d’étendre leurs activités à plus grande échelle.
Les redevances de développement et les retards freinent encore davantage l’offre de logements. Une étude de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations a révélé qu’en 2024, les frais municipaux liés aux nouveaux projets résidentiels ont augmenté en moyenne de 3 000 dollars canadiens pour un logement en immeuble de grande hauteur depuis 2022, portant la nouvelle moyenne au Canada au moment de l’étude de 2024 à 35 000 dollars.
Dans l’ensemble, les coûts supplémentaires et les retards découragent l’investissement dans le logement. De mars à avril 2025, la valeur totale des permis de construction délivrés au Canada a diminué de 829,6 millions de dollars canadiens (-6,6 %) pour s’établir à 11,7 milliards de dollars canadiens.
10) Différents régimes pour les rapports ESG :
Il existe plusieurs cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui se chevauchent au Canada, notamment des cadres provinciaux, fédéraux et sectoriels. Nous avons identifié six régimes fédéraux pour les facteurs ESG au Canada, contre quatre aux États-Unis et cinq dans l’Union européenne. Si bon nombre de ces normes sont volontaires, de nombreux organismes de réglementation font référence à ces lignes directrices, comme une voie vers la déclaration obligatoire.
Les normes ESG sont bénéfiques ; certaines études montrent que leur mise en œuvre est corrélée à une augmentation de la rentabilité des entreprises canadiennes. Cependant, se conformer à des exigences ESG multiples et redondantes n’est ni efficace ni économique, les entreprises étant souvent obligées d’augmenter leurs effectifs et de faire appel à des spécialistes, des experts externes et des auditeurs pour répondre aux nombreuses exigences en matière de déclaration.
- La règle sur la divulgation des renseignements relatifs à la diversité en matière de gouvernance d’entreprise des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) a été intégrée en 2020. Elle exige des entreprises de divulguer la représentation des femmes au sein de leur conseil d’administration et dans les postes de la haute direction. L’objectif est de divulguer des informations sur la diversité et d’encourager la diversité au sein des équipes de direction. Cette règle a été promulguée par le gouvernement fédéral. Bien qu’elle soit obligatoire, la pénalité en cas de non-respect n’est pas clairement définie. Les ACVM avaient l’intention d’ajouter de nouvelles obligations d’information liées au climat et d’élargir la portée des divulgations sur la diversité au-delà des femmes, mais elles ont suspendu ce projet après les attaques du président américain Donald Trump contre les politiques en matière d’EDI et d’ESG.
- Le Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité (CCNID) a publié ses Normes canadiennes d’information sur la durabilité (NCID) en décembre 2024. Il est important de noter que ces normes sont basées sur les normes IFRS d’information sur la durabilité publiées par l’International Sustainability Standards Board et constituent une avancée importante dans la consolidation internationale des cadres ESG. Les normes canadiennes sont divisées en deux. Premièrement, la norme NCID 1 porte sur les informations financières et les occasions et risques liés à la durabilité ; deuxièmement, la norme NCID 2 fournit des informations sur les occasions et risques liés au climat, y compris les risques physiques et de transition. Ces deux normes sont facultatives, mais elles pourraient être intégrées de façon permanente à la législation canadienne sur les valeurs mobilières si elles sont adoptées par les ACVM à l’avenir.
- Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a introduit de nouvelles règles sur la communication d’informations en matière de climat pour les institutions financières fédérales (IFF), qui sont entrées en vigueur en 2024. Ces règles obligent les IFF à suivre et à communiquer des indicateurs liés au climat, notamment les divulgations, les émissions de GES du champ d’application 1 et du champ d’application 2, les risques et les stratégies d’atténuation. Cette tâche importante exige des entreprises qu’elles développent des capacités et des infrastructures supplémentaires pour collecter et présenter les informations requises. Plusieurs groupes industriels ont signalé des difficultés liées à la précision des mesures, au manque de données et à l’insuffisance des orientations et des détails. Ils ont également demandé une coopération accrue entre le Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité (CCNID) et les ACVM en matière de réglementation.
- Le projet de loi C-59 a été présenté dans l’Énoncé économique de l’automne 2023 ; il comprenait une modification visant à lutter contre l’écoblanchiment et à renforcer la crédibilité des avantages environnementaux. Cependant, les entreprises étaient déjà confrontées à des risques de poursuites pour allégations d’écoblanchiment en vertu des lois fédérales et provinciales existantes, notamment l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence. La modification relative à l’écoblanchiment a été vivement critiquée, car elle obligeait les entreprises à prouver leurs allégations environnementales à l’aide d’une « méthodologie internationalement reconnue » sans préciser de quelle méthodologie il s’agissait. D’autres critiques portent sur le renversement du fardeau de la preuve, l’octroi de « droits privés d’action » et l’élargissement des pouvoirs du Bureau de la concurrence en matière de réglementation des activités commerciales. Il est important de noter que ces dispositions ajoutent une couche supplémentaire de complexité à l’obligation de déclaration des entreprises au Canada.
- La Loi sur l’esclavage moderne : Au plus tard le 31 mai de chaque année, les entreprises dont les actifs dépassent 40 millions de dollars ou dont le revenu est supérieur à 20 millions de dollars doivent déposer un rapport auprès du ministère de la Sécurité publique attestant que leurs chaînes d’approvisionnement n’ont pas recours au travail forcé ou au travail des enfants. Un objectif louable, mais des instructions compliquées. Pour se conformer, les grandes entreprises établissent des codes de conduite avec tous leurs fournisseurs, leur demandent de détailler leurs pratiques en matière de travail, puis valident toutes les informations. Le projet de loi est entré en vigueur en janvier 2024 et la date limite pour la première soumission était fixée au 31 mai 2024. En raison du calendrier serré et du manque de clarté quant aux exigences, seules environ 5 650 entreprises ont déposé un rapport au titre du projet de loi S-211 avant la date limite. Les entreprises doivent déployer des efforts considérables pour recueillir les données nécessaires à l’élaboration du rapport, passer par un processus d’approbation et d’attestation, puis remplir un long questionnaire en ligne. Le gouvernement n’a pris aucune mesure coercitive en 2024, a reconnu les défis à relever et a sollicité des commentaires afin de mettre à jour les orientations fournies aux entreprises. Pour 2025, les rapports devaient être remis au plus tard le 31 mai 2025, et de nouvelles directives sont attendues à l’automne.
- Le Canada a également mis en place le Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE), qui a pour mandat d’encourager les entreprises à respecter certaines normes internationales relatives aux droits de la personne dans la chaîne d’approvisionnement, et de recevoir et d’examiner des plaintes concernant la conduite des entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger. Toutefois, les rapports d’évaluation initiale des plaintes soumises à l’ombudsman n’ont été publiés que près de quatre ans après sa création.
- La taxonomie de l’investissement durable a été introduite par le ministère des Finances en octobre 2024. Elle définit les investissements qui contribuent à une économie carboneutre en définissant les activités « vertes » ou « de transition ». Les entreprises doivent également évaluer un projet au regard des nouvelles exigences d’« absence de préjudice important » énoncées dans les lignes directrices. Les lignes directrices ne couvrent pas tous les secteurs ; elles se concentrent sur l’électricité, les transports, l’immobilier, l’agriculture et la foresterie, la fabrication et les industries extractives, y compris le traitement et l’extraction des ressources minières et le gaz naturel. La taxonomie de l’investissement a été créée pour encourager le financement de la lutte contre les changements climatiques par différentes institutions, telles que les banques, les fonds de pension et les entreprises de gestion d’actifs. Elle n’est pas obligatoire, mais devrait le devenir dans un avenir proche.
CONCLUSION :
Soyons clairs : les entreprises canadiennes reconnaissent et soutiennent la nécessité de protéger les personnes, les communautés et l’environnement. La santé, la sécurité et la confiance du public sont essentielles au bon fonctionnement de l’économie. Mais les règles et les règlements qui sont souvent contradictoires, changeants ou imprécis ne servent pas leur objectif.
La liste présentée ici n’est pas exhaustive et ne cherche pas à remettre en question les objectifs politiques sous-jacents des règlements. Elle vise plutôt à mettre en évidence certains des coûts de mise en conformité liés au respect de règles qui, trop souvent, sont excessives ou complexes au point de perdre tout leur sens. À notre avis, c’est par cette liste que le gouvernement devrait commencer s’il souhaite apporter une aide immédiate et efficace pour atténuer les effets les plus néfastes du fardeau réglementaire.
Alors que le Canada traverse une période d’incertitude sans précédent, les décideurs politiques sont particulièrement bien placés pour examiner l’ensemble des exigences réglementaires existantes et déterminer comment les capitaux peuvent être déployés dans l’économie plutôt que dans des exigences réglementaires redondantes ou obsolètes.
Cependant, des chercheurs innovants dotés des bons outils d’IA pourraient en effet compiler des listes exhaustives des règlements, suivre les interactions entre les règles qui se chevauchent et les administrations contradictoires, puis attribuer un prix à chaque point de contact avec les entreprises.
Les organismes de réglementation et les différents ordres de gouvernement doivent déterminer qui fait quoi et déléguer en conséquence afin de rationaliser le système, et de garantir que la croissance économique et l’intérêt public puissent coexister, voire prospérer ensemble.
D’ici là, nous espérons avoir donné à ceux qui sont chargés d’alléger le fardeau réglementaire un point de départ. Le Canada ne peut pas se permettre d’attendre.
Reconnaissance
Recherche et rédaction par Heather Scoffield et Daniela Lombardo, Conseil canadien des affaires. Des sondages ont été menés auprès de divers membres du CCA entre février et juin 2025.
Droits d’auteur
© Conseil canadien des affaires, 2025
Citation du rapport
Conseil canadien des affaires (5 septembre 2025). Étouffé par la bureaucratie. thebusinesscouncil.ca/report/stifled-by-red-tape
À propos du Conseil canadien des affaires
Fondé en 1976, le Conseil canadien des affaires est un organisme sans but lucratif et non partisan qui représente les chefs d’entreprise de toutes les régions et de tous les secteurs du pays. Les entreprises membres du Conseil emploient plus de deux millions de Canadiens, contribuent à la plus grande part de l’impôt fédéral sur les sociétés et sont responsables de la majeure partie des exportations, du mécénat d’entreprise et des investissements du secteur privé en recherche et développement du Canada. Grâce à des partenariats dans la chaîne d’approvisionnement, des contrats de service et des programmes de mentorat, les membres du Conseil canadien des affaires soutiennent également des centaines de milliers de petites entreprises et d’entrepreneurs dans des collectivités de toutes tailles, partout au Canada.
Avis de non-responsabilité
Ce rapport reflète les opinions du Conseil canadien des affaires. Ce rapport peut ou non refléter nécessairement le point de vue des membres individuels du Conseil canadien des affaires et ne doit donc pas être attribué à un ou plusieurs membres.